|
Événements |
 |
 |
|
Renforcement des systèmes de santé en vue de la couverture sanitaire universelle |
 |
 |
Couverture sanitaire universelle
En 2013, l’OMS a plaidé auprès de ses États Membres en faveur d’une progression vers la couverture sanitaire universelle afin d’élargir la couverture de la population, de garantir la disponibilité et l’accessibilité des services de santé nécessaires et d’améliorer la protection financière des bénéficiaires des services de soins de santé. La transition vers la couverture sanitaire universelle a non seulement permis aux États Membres d’accélérer les progrès, mais elle a également fait apparaître les lacunes et les défis concernant les différentes composantes des systèmes de santé qu’il faudra prendre en compte pour accélérer cette transition.
Lors de sa soixantième session, le Comité régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale a tenu des discussions sur les défis et les opportunités concernant la progression vers la couverture sanitaire universelle et a approuvé une vision, une stratégie et une feuille de route (EM/RC60/R.2) pour les États Membres. Des profils synthétiques succints des systèmes de santé ont été préparés pour chaque pays, offrant un aperçu de la performance du système de santé ainsi qu’une brève présentation des défis et des priorités pour le renforcement des systèmes de santé en vue de la réalisation de la couverture sanitaire universelle.
Un évènement international a par la suite été organisé au cours duquel de hauts représentants de vingt pays de la Région ainsi que des experts et partenaires de développement internationaux et régionaux, tels que la Banque mondiale, ont approuvé un cadre d’action qui orientera le soutien qui sera apporté aux pays dans leur progression vers la couverture sanitaire universelle. Parmi les activités visant à renforcer les capacités des systèmes de santé pour réaliser la couverture sanitaire universelle figurent des séminaires-ateliers pour le groupe sous-régional du Conseil de coopération du Golfe, les pays du G5, ainsi que les pays pouvant bénéficier du soutien de l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI).
Les activités menées en 2014 et au-delà seront axées sur l’appui aux États Membres pour la mise en œuvre du cadre d’action et sur l’évaluation des progrès accomplis par les pays en ce qui concerne la réalisation de la couverture sanitaire universelle.
Financement de la santé
Comme indiqué dans le rapport annuel de l’année dernière, la Région se caractérise par des paiements directs représentant une part élevée des frais de santé, ce qui constitue un obstacle majeur à la transition vers la couverture sanitaire universelle. De nombreux pays appartenant aux trois groupes de la Région2 n’ont toujours pas de vision claire quant à la manière d’améliorer leurs systèmes de financement de la santé. Il existe une méconnaissance des concepts de financement de la santé ainsi qu’un manque de capacités pour la conduite d’études et l’élaboration d’outils de financement de la santé ; il s’agit en particulier des comptes nationaux de la santé, de l’analyse organisationnelle en vue de l’amélioration et du renforcement du financement de la santé (OASIS), des enquêtes sur les dépenses de santé des ménages et de l’utilisation des services, des études sur le rapport coût-efficacité et enfin de l’application de ces outils pour servir de base à la prise de décision.
Plusieurs activités ont été organisées afin de renforcer les capacités nationales et régionales en matière de promotion des concepts et d’utilisation d’outils de financement de la santé en vue de mobiliser les pays autour d’un débat sur le renforcement des systèmes nationaux de financement de la santé. Les expériences mondiales en matière de progrès vers la couverture sanitaire universelle ont été partagées lors de la réunion de haut niveau consacrée à l’accélération des progrès en vue de la réalisation de la couverture sanitaire universelle. Plus de 100 délégués y ont participé, dont des ministres de la Santé et des responsables de l’élaboration des politiques, des partenaires de développement, des organisations de la société civile et des experts mondiaux. Début 2013, un séminaire de haut niveau a été organisé sur les options de financement des soins de santé dans la Région, suivi d’une réunion sous-régionale sur le financement de la santé pour les États Membres du Conseil de coopération du Golfe, qui comprend les pays du groupe 1. Entre autres questions, le cas particulier des non-ressortissants a fait l’objet de discussions et des solutions ont été proposées sur la manière de leur fournir une couverture. Deux activités de renforcement des capacités régionales sur les comptes nationaux de la santé et l’établissement des coûts grâce au logiciel OneHealth, outil d’estimation des coûts, ont été organisées. De plus, des séminaires-ateliers sur le financement de la santé spécifique à certains pays ont été organisés dans trois pays, et le Maroc a apporté son soutien pour l’organisation d’une conférence sur les systèmes de santé nationaux visant à élaborer une vision pour les futurs systèmes de santé. Plusieurs documents d’orientation ont été élaborés sur des sujets clés relatifs à la couverture sanitaire universelle, notamment son caractère multisectoriel et le rôle des stratégies d’achat.
Il reste certes encore beaucoup à faire dans ce domaine. Il est prévu en effet de renforcer les capacités techniques de l’OMS en matière de financement de la santé afin de pouvoir fournir des conseils aux États Membres et de renforcer leurs capacités en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de financement de la santé efficaces pour réaliser la couverture sanitaire universelle.
Gouvernance de la santé
L’amélioration de la gouvernance de la santé reste un problème majeur pour l’ensemble des pays, alors qu’ils tendent vers un renforcement de l’équité et de la justice en matière de prestation de soins de santé, l’actualisation des lois relatives à la santé publique et l’amélioration de la responsabilisation. Le droit à la santé – ou la santé en tant que droit de l’homme – ne constitue pas encore un élément essentiel de l’élaboration des politiques. La nécessité de renforcer les capacités en matière de diplomatie sanitaire et de renforcer la coordination avec la politique étrangère et d’autres secteurs est de plus en plus apparente car la santé assume un rôle dont l’importance est croissante dans le programme de développement mondial. Le deuxième séminaire régional sur la diplomatie sanitaire a été organisé à l’intention de responsables des affaires étrangères et de la santé dans le but d’encourager la coordination entre les deux secteurs pour faire face aux défis sanitaires qui requièrent des solutions et des compétences politiques. Dans le cadre du soutien en vue de l’amélioration de la gouvernance, de la responsabilisation et de la transparence, des évaluations ont été organisées dans douze pays afin de mieux comprendre le rôle du ministère de la Santé en matière d’élaboration de politiques et de planification. Quatre pays ont bénéficié d’un appui technique pour l’examen de leurs politiques et stratégies nationales respectives de santé. Deux outils d’évaluation ont été élaborés pour soutenir le développement des systèmes de santé. Le premier a été utilisé pour évaluer la situation en matière de droit à la santé dans quatre pays, et le deuxième visait à évaluer la législation relative à la santé publique dans cinq pays. Une réunion d’experts a permis d’identifier les lacunes des lois relatives à la santé publique dans la Région et d’encourager des actions pour y remédier, notamment la mise en place d’un réseau régional d’experts en droit de la santé publique. Les activités se poursuivront en 2014 et au-delà afin d’élaborer des orientations claires pour les pays en matière de renforcement de la législation sanitaire. En 2014, une attention particulière sera accordée à la prévention des maladies non transmissibles.
Les crises politiques et les troubles sociaux que connaissent de nombreux pays de la Région sont particulièrement préoccupants et ils ont entraîné une prédominance des activités d’urgence dans le secteur de la santé. Cette situation a contribué à affaiblir davantage les institutions gouvernementales dans certains pays et à réduire leur capacité à renforcer et à améliorer la prévisibilité de l’assistance extérieure, ainsi que leur alignement et leur harmonisation avec les priorités du gouvernement.
Développement des personnels de santé
Parmi les difficultés majeures auxquelles sont confrontés les pays dans le domaine du développement des personnels de santé figurent la pénurie et la mauvaise répartition des effectifs, en particulier des personnels infirmiers, des sages-femmes et des auxiliaires de santé ainsi que la formation, la formation continue et la fidélisation de professionnels compétents. Dans plusieurs pays des groupes 2 et 3, on observe une faible performance des systèmes de gestion des ressources humaines ainsi qu’une coordination insuffisante en matière de développement des personnels de santé. La nécessité de veiller à ce que les migrations, déplacements, droits et obligations des personnels de santé soient en conformité avec le Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé constitue une préoccupation majeure pour l’ensemble de la Région.
Alors que les lacunes en matière de développement des personnels de santé sont indéniables, les solutions pour y faire face ne sont pas toujours manifestes pour les États Membres. Afin de relever ce défi, des activités ont été lancées en 2013 en vue d’élaborer une stratégie complète visant à aider les pays à mettre en œuvre des approches efficaces pour ce qui concerne la production, la répartition, la formation et la fidélisation des professionnels de santé. Cette stratégie, qui sera fondée sur un examen des expériences à l’échelle régionale et internationale, fera l’objet de discussions lors d’une réunion interpays en 2014.
Il ressort clairement de la collaboration étroite avec les pays que la plupart des États Membres ne disposent pas de capacités suffisantes en matière de santé publique. Le soutien aux pays dans ce domaine particulier constitue une priorité pour le Bureau régional. Les expériences et les compétences en santé publique sont indispensables au développement sanitaire national. Une consultation régionale a permis de passer en revue les options pour renforcer les capacités en santé publique, et de mener des discussions sur les moyens d’élaborer un programme régional de leadership en matière de santé publique, et d’améliorer la qualité de la formation en santé publique, abordant la question de la dichotomie entre l’enseignement et la pratique, et enfin d’améliorer l’investissement dans la recherche en santé publique. Nous collaborons désormais avec d’autres institutions internationales de santé publique afin de mettre en place un programme de leadership en matière de santé publique destiné aux administrateurs de santé publique de niveau intermédiaire dans les États Membres, à compter de 2014.
Les soins infirmiers et obstétricaux sont une autre question qui réclame une attention accrue. Une consultation sur la formation des personnels infirmiers a été organisée afin de passer en revue et d’actualiser les normes régionales en matière de formation des personnels infirmiers et des sages-femmes, et d’élaborer un cadre régional en vue d’une spécialisation en soins infirmiers. Un prototype de programme d’enseignement pour la formation en soins infirmiers avant l’emploi et un prototype de programme avancé pour une spécialisation, dans le cadre d’une formation supérieure en soins infirmiers psychiatriques ont été élaborés.
L’OMS a apporté un soutien au renforcement des capacités nationales dans des domaines tels que le leadership et la gestion pour les personnels infirmiers et les sages-femmes, et dans la manière de réaliser des projections des effectifs de santé.
La réglementation en matière de soins infirmiers et obstétricaux a été renforcée dans trois pays. En Afghanistan, un plan national stratégique des ressources humaines pour la santé et un plan stratégique destiné aux dix instituts des sciences de la santé en vue de la promotion du développement pédagogique pour les soins infirmiers et obstétricaux, les sciences paramédicales et de l’augmentation de la production ont été finalisés.
Quatre-vingt-quatorze (94) boursiers de pays de la Région ont bénéficié du programme régional de bourses d’études.
Nous estimons que ces dernières années, il n’a pas été accordé suffisamment d’attention aux activités de l’OMS en matière de renforcement de la formation médicale, malgré les importants défis auxquels sont actuellement confrontés les pays dans ce domaine. Dans le cadre des efforts d’intensification, nous devons dans un premier temps mener une analyse exacte de la situation, identifier les obstacles et parvenir à un consensus quant aux priorités. Ainsi, une importante étude sur la formation médicale dans les pays de la Région a débuté, en coordination avec la Fédération mondiale pour l’enseignement de la médecine. Cette étude a pour objectif d’examiner la qualité et la pertinence des programmes de formation médicale dans l’ensemble de la Région, d’échanger des informations sur les meilleures pratiques et d’identifier les domaines à améliorer. Nous prévoyons de fournir des orientations stratégiques claires dans ce domaine d’action en 2014.
Lors du troisième Forum mondial des ressources humaines pour la santé, quatorze États Membres ont pris des engagements et ont convenu de surveiller les progrès accomplis dans ce domaine et d’en rendre compte. Ce forum était organize par l’Agence mondiale pour les personnels de santé, dont l’OMS abrite le siège.
Technologies et médicaments essentiels
L’accès aux produits médicaux, notamment les médicaments, les vaccins, les produits sanguins, les diagnostics et les dispositifs médicaux essentiels, demeure un problème qui pour beaucoup de pays est amplifié par l’incapacité à faire pleinement appliquer l’utilisation de médicaments génériques de qualité garantie, l’usage non rationnel des médicaments, ainsi que par l’inefficacité des systèmes d’achat et de distribution. De plus, les pays n’ont pas pleinement utilisé les outils disponibles (tels que l’outil d’évaluation des technologies de la santé) leur permettant de prendre des décisions éclairées quant aux investissements dans la technologie de la santé. La nécessité de renforcer les autorités nationales de réglementation dans la plupart des pays découle des défis qui se posent dans le domaine des médicaments essentiels et des technologies de la santé.
Des mesures importantes ont été prises pour faire avancer l’utilisation de l’évaluation des technologies de la santé dans la Région avec notamment l’organisation d’une réunion interpays sur le sujet à laquelle ont participé dix-huit pays. La réunion a donné l’impulsion pour la mise en place d’un réseau composé d’experts régionaux et internationaux de l’évaluation des technologies de la santé ainsi que la mise en œuvre de programmes nationaux et la cartographie des ressources existantes aux niveaux national et régional dans le domaine de l’évaluation des technologies de la santé.
Les documents de politique pharmaceutique nationale ont été mis à jour dans deux pays, et dix-huit pays ont vu leurs capacités renforcées pour mener des enquêtes visant à évaluer le secteur pharmaceutique national en utilisant la Phase II de la méthodologie de l’OMS.
Les activités visant à améliorer l’accès aux médicaments et aux technologies de la santé comprenaient notamment le renforcement des capacités de réglementation. Des formations ont été organisées pour quelques pays en 2013 ; cependant, ce domaine exige d’importants efforts de la part de l’OMS en vue de renforcer le soutien technique aux États Membres en 2014 et au-delà. Le renforcement des capacités s’est poursuivi dans le cadre du programme de bonne gouvernance dans le secteur pharmaceutique de l’OMS.
Prestation de services intégrée
Les trois groupes de pays sont confrontés à des défis différents dans leurs systèmes de santé. Les principaux problèmes rencontrés dans la prestation de services sont l’élargissement de l’accès, l’amélioration de la qualité des soins et le renforcement des systèmes d’orientation-recours. En plus de la nécessité d’améliorer la formation, le déploiement, la répartition et le développement des personnels de santé, il faudra renforcer les capacités des prestataires de soins de santé en matière de gestion des ressources financières et humaines. Les mauvaises capacités de gestion se doublent de l’absence d’une véritable autonomie des hôpitaux et de partenariats public-privé.
La qualité des soins et le niveau de sécurité des patients doivent être améliorés. Des études menées dans certains pays ont démontré que la prévalence des effets indésirables atteignait 18 % des hospitalisations.
Plusieurs études visant à mieux comprendre les défis de la prestation de services de santé dans les pays ont été menées. Et pour la première fois, une analyse régionale du secteur de santé privé a été menée et présentée lors des sessions de travail préalables au Comité régional. Une évaluation des principales caractéristiques des opérations générales, des structures de contrôle interne et des aspects de la prestation de services des hôpitaux du secteur privé a été achevée dans tous les pays. Les résultats de l’évaluation indiquent que dans la Région, la durée moyenne d’hospitalisation d’un patient est de près de cinq jours (comprise entre trois et huit jours) et le taux moyen d’occupation des lits d’hôpitaux est de 85 % (33 – 100 %). Une étude cartographique sur l’accréditation des institutions de soins de santé a également été menée dans la Région.
Plusieurs outils et lignes directrices ont été élaborés ou actualisés. Il s’agit notamment d’une approche conceptuelle et stratégique pour la mise en place de programmes de médecine familiale ; de lignes directrices visant à intensifier le programme des agents de santé communautaires dans les pays, en tant qu’approche pour la réalisation de la couverture sanitaire universelle ; de lignes directrices pour la mise en place de programmes de soins de santé à domicile pour les personnes âgées ; et d’un manuel sur la réduction des risques de catastrophes dans la communauté, qui a été élaboré en collaboration avec le programme régional sur les situations d’urgence et l’action humanitaire. De plus, l’outil d’évaluation de la sécurité des patients a été révisé et un programme de formation sur la sécurité des patients destiné aux écoles de médecine a été traduit en arabe et largement diffusé.
Tous les pays ont besoin d’un appui pour mettre en place et maintenir des programmes de médecine familiale efficaces. On accordera la priorité à ce domaine en 2014 par le biais d’une évaluation de la situation actuelle en matière de médecine familiale dans les pays de la Région ainsi que d’un examen des expériences à l’échelle internationale et l’élaboration d’approches visant à renforcer la médecine familiale en vue de réaliser la couverture sanitaire universelle.
Systèmes d’information sanitaire
En ce qui concerne les systèmes d’information sanitaire dans la Région, la situation est très variable. En effet, dans de nombreux pays, il existe plusieurs domaines nécessitant d’être renforcés, notamment les politiques et la législation, les ressources humaines et matérielles, des indicateurs de surveillance et d’évaluation, et enfin les compétences pour collecter, analyser et diffuser des informations précises et à jour afin de servir de base à la prise de décisions. Suite à l’adoption en 2012 de la résolution EM/RC59/R.3 sur le renforcement des systèmes de santé, des efforts concertés ont été déployés afin d’aider les pays à améliorer leurs systèmes d’information sanitaire. Une analyse de la situation en ce qui concerne l’enregistrement des actes et de statistiques d’état civil a été conduite dans l’ensemble des pays au moyen d’une approche d’évaluation rapide visant à identifier les lacunes et les défis principaux. Les résultats de cette évaluation ont fait l’objet de discussions lors d’une réunion régionale de parties prenantes ayant pour objectif de parvenir à un consensus quant aux moyens permettant d’améliorer le niveau et la qualité de l’enregistrement des naissances et des décès. Des évaluations complémentaires approfondies ont été réalisées dans près de la moitié des pays, et les résultats ont été utilisés pour élaborer une stratégie en vue du renforcement de l’enregistrement des actes et de statistiques d’état civil, qui a été approuvée par le Comité régional (EM/RC60/R.7).
Afin d’aider les pays à renforcer leurs systèmes d’information sanitaire, une liste essentielle d’indicateurs qui couvre les risques sanitaires et les déterminants de la santé, la situation sanitaire et les performances du système de santé a été élaborée. Des discussions ont eu lieu à ce sujet lors d’une réunion interpays et l’initiative consistant à disposer d’une liste convenue d’indicateurs a par la suite été approuvée par le Comité régional. La situation sanitaire actuelle dans les pays a été examinée par rapport à chacun des indicateurs de base, en termes de recueil de données, de production de données, d’analyse, de diffusion et d’utilisation en vue de l’élaboration de politiques et de l’évaluation. Les lacunes mises en évidence dans ces domaines feront l’objet de discussions lors d’une réunion interpays prévue en 2014. Un Observatoire régional de la santé a été lancé afin de veiller à ce que toutes les informations sanitaires soient accessibles et utilisées pour une meilleure planification tant au niveau régional que national ; et cette liste essentielle d’indicateurs en fera partie. Certains États Membres ont, à maintes reprises, signalé des différences entre les estimations de la mortalité maternelle et infantile produites par les institutions des Nations Unies et les chiffres enregistrés au niveau national. Afin de réduire les défauts de concordance et de veiller à ce que le processus de consultation avec les autorités nationales soit mené de manière transparente et en temps opportun, une réunion s’est tenue avec les pays sur les estimations de la mortalité maternelle et infantile produites par le Groupe interinstitutions des Nations Unies pour la surveillance des objectifs du Millénaire pour le développement 4 et 5.
Cybersanté
À l’heure actuelle, la cybersanté n’est que très peu utilisée dans les systèmes de santé de la Région. Des stratégies nationales concernant la cybersanté doivent être élaborées afin de relever les défis financiers auxquels sont confrontés les systèmes de santé, et de faire face à la demande croissante d’efficacité et aux attentes plus grandes des citoyens. Dans sa résolution (WHA66.24), l’Assemblée mondiale de la Santé invite instamment les États Membres à élaborer des politiques nationales et à prévoir des services de cybersanté appropriés ainsi que la mise en œuvre de normes relatives aux données de santé dans leur pays.
Alors que plusieurs pays ont lancé diverses initiatives dans différents domaines, il existe des lacunes reconnues en ce qui concerne les capacités nationales à gérer la mise en œuvre de stratégies et de politiques nationales. L’adoption et la mise en œuvre de normes relatives aux données de santé progressent lentement et l’absence de réseaux nationaux pour soutenir la circulation de l’information au sein du système de santé constitue un obstacle au développement de la cybersanté.
Les principaux aspects à prendre en considération dans l’élaboration d’une stratégie nationale ont été mis en évidence lors d’une réunion régionale au cours de laquelle l’initiative HealthNet visant à mettre en place des réseaux nationaux de santé dynamiques, fiables et opérationnels a été lancée. Le Bureau régional a assuré la coordination avec les points focaux nationaux afin d’achever une enquête sur la cybersanté et l’innovation dans la santé de la femme et de l’enfant menée par l’Observatoire mondial de la cybersanté de l’OMS.
Une analyse préliminaire indique que deux des neuf pays concernés ont partiellement mis en œuvre des politiques nationales de cybersanté, qui à présent doivent être actualisées ; sept pays disposent d’au moins un système d’information électronique pour recueillir et notifier les données sanitaires au niveau du district ; et enfin trois pays dotés d’initiatives majeures consacrées à la santé des femmes et des enfants soutenues par la cybersanté.
2Les pays ont été répartis en trois grands groupes selon les résultats en matière de santé dans la population, les performances du système de santé et le niveau des dépenses de santé : Groupe 1 : Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar ; Groupe 2 : Égypte, République islamique d’Iran, Iraq, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, République arabe syrienne, Territoire palestinien occupé, Tunisie ; Groupe 3 : Afghanistan, Djibouti, Pakistan, Somalie, Soudan et Yémen. |
|
|
Renforcement des systèmes de santé en vue de la couverture sanitaire universelle |
 |
 |
|
En 2012, le Comité régional a adopté une résolution qui approuvait une proposition de feuille de route pour le renforcement des systèmes de santé en tant que priorité stratégique et les mesures nécessaires pour promouvoir la couverture universelle par des services de santé de qualité au niveau de la population et des particuliers. La résolution était fondée sur une analyse approfondie des difficultés que la Région connaît en matière de développement sanitaire, menée par le Bureau régional en 2012, et sur l’examen des activités de soutien aux États Membres que déploie l’OMS pour y faire face.
Les systèmes de santé de la Région doivent relever de nombreux défis, qui sont généralement de nature transversale, et ce dans la plupart des pays, indépendamment du niveau de développement socioéconomique et sanitaire. Il est essentiel de s’attaquer à ces difficultés pour atteindre la couverture sanitaire universelle. Les pays sont répartis en trois groupes selon les résultats en matière de santé dans la population, les performances du système de santé et le niveau des dépenses de santé (voir tableau 1). Dans les pays des groupes 2 et 3, le financement est insuffisant et les paiements directs représentent une part élevée des frais de santé. Dans certains pays à revenu faible, ils atteignent 75 % du total des dépenses de santé. Des paiements directs importants constituent un obstacle majeur dans la progression vers la couverture sanitaire universelle. (Figure 1) D’autres problèmes – faire face au manque de services de soins de santé complets, centrés sur la personne et de qualité, veiller à ce que les personnels de santé soient compétents et en nombre suffisant, améliorer l’accès aux technologies et médicaments essentiels et combler les lacunes actuelles des systèmes d’information sanitaire – devront également être pris en compte si l’on veut réaliser la couverture sanitaire universelle. Pour de nombreux pays, le principal défi est la nécessité d’une volonté et d’un engagement politiques de haut niveau pour progresser vers la couverture sanitaire universelle avec des services de santé de qualité au niveau de la population et des particuliers.
|
Tableau 1.Tendance des principaux résultats sanitaires dans la Région de la Méditerranée orientale,1990-2010*
|
| Indicateur de la situation sanitaire |
Pays du groupe 1
|
Pays du groupe 2
|
Pays du groupe 3
|
|
1990
|
2000
|
2010
|
1990
|
2000
|
2010
|
1990
|
2000
|
2010
|
|
Espérance de vie à la naissance (année)
|
72.6
|
74.1
|
75.0
|
69.2
|
71.2
|
73.4
|
52.8
|
56.6
|
60.2
|
|
Taux de mortalité maternelle (pour100 000 naissances vivantes)
|
24.0
|
18.0
|
17.0
|
115
|
79
|
63
|
750
|
625
|
360
|
|
Taux de mortalité infantile (pour1000 naissances vivantes)
|
17.5
|
–
|
8.5
|
36.5
|
–
|
19
|
95.5
|
–
|
71.5
|
|
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000 naissances vivantes)
|
21.5
|
–
|
9.5
|
45.5
|
–
|
22
|
126.5
|
–
|
97
|
|
Indice synthétique de fécondité
|
5.2
|
3.9
|
2.2
|
5.6
|
3.7
|
2.9
|
6.6
|
6.3
|
6.0
|
* Les valeurs sont des médianes
– Informations non disponibles
Source : Renforcement des systèmes de santé dans les pays de la Région de la Méditerranée orientale : difficultés, priorités et options pour les actions futures. Document technique présenté à la cinquante-neuvième session du Comité régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale, 2012. (disponible à l’adresse http://www.emro.who.int/fr/about-who/rc59/)
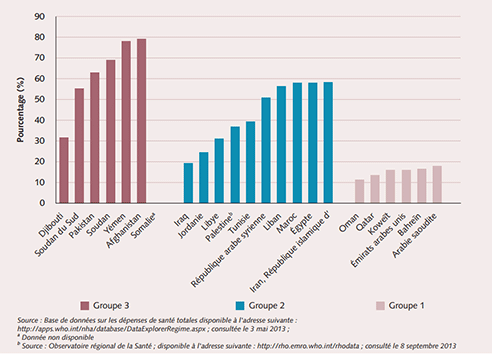
Figure 1. Part des dépenses directes dans les dépenses de santé totales par groupe de pays, 2011 (en %)
Financement de la santé et gouvernance
Dans la Région, les activités de l’OMS en matière de financement de la santé ont été relancées par la publication du Rapport sur la santé dans le monde 2010, consacré à la réforme des systèmes de financement de la santé pour atteindre la couverture sanitaire universelle. En 2012, des pays de chacun des trois groupes ont demandé un soutien dans ce domaine. L’OMS s’est également attachée à renforcer les capacités nationales pour produire les données nécessaires à des politiques de financement de la santé équitables, efficaces et pérennes. Ce soutien comprenait un séminaire-atelier de renforcement des capacités pour le nouveau système de comptes de la
santé (SCS 2011), auquel ont participé des experts du financement de la santé d’onze pays, et un exercice de renforcement des capacités sur l’utilisation du nouvel outil OMS pour l’analyse organisationnelle en vue de l’amélioration et du renforcement du financement de la santé (Organizational Assessment for Improving and Strengthening Health Financing ou OASIS), visant à évaluer les obstacles qui sapent les performances des systèmes de financement de la santé. Le Bureau régional a donné la priorité à l’évaluation des progrès accomplis sur la voie de la couverture sanitaire universelle dans la Région. Un cadre d’évaluation a été élaboré et doit être mis en œuvre en 2013. Son but est de soutenir les États Membres et l’OMS pour ce qui est d’évaluer l’équité du financement de la santé et de suivre les progrès quant à la protection sociale en matière de santé.
Deux événements ont permis aux États Membres d’échanger leurs données d’expérience sur la réforme des systèmes de financement de la santé pour progresser vers la couverture sanitaire universelle : il s’agit du dialogue politique entre les ministres des Finances et de la Santé sur l’optimisation des ressources, la soutenabilité et la redevabilité dans le secteur de la santé, qui a eu lieu en Tunisie pour les États Membres africains en collaboration avec la Banque africaine de développement et d’autres organismes de développement ; et de la réunion exceptionnelle sur le financement de la santé et la couverture sanitaire universelle, qui s’est tenue lors de la cinquante-neuvième session du Comité régional. Lors de ces deux événements, les pays ont pris part aux débats mondiaux actuels sur le financement des soins de santé et son rôle essentiel pour faire avancer le programme d’action concernant la couverture sanitaire universelle. Suite à ces événements, un séminaire de haut niveau sur le financement de la santé s’est tenu au Caire, en janvier 2013.
Les divers outils d’analyse du financement de la santé sont utilisés en vue de produire des résultats qui pourront servir aux dialogues politiques nationaux sur l’avenir du financement de la santé dans les différents contextes locaux. En Libye, à Oman et en Tunisie, le Bureau régional a facilité ces dialogues et axé les discussions sur le financement de la santé. Il a aussi fourni un soutien technique à d’autres pays. Des efforts sont en cours pour cartographier le financement de la santé et évaluer la situation des pays par rapport à leurs objectifs en la matière et à la transition vers la couverture sanitaire universelle. Ces efforts ont attiré l’attention de divers responsables de l’élaboration des politiques.
Les capacités des ministères de la Santé pour l’élaboration et l’évaluation des politiques et plans fondés sur des bases factuelles, ainsi que pour la réglementation du secteur de la santé, sont souvent insuffisantes et varient selon les pays. Dans presque tous les pays, il faut renforcer l’engagement des secteurs clés autres que celui de la santé, ce qui est essentiel pour élaborer et mettre en œuvre des politiques sanitaires dans le cadre des plans de développement nationaux. Des mécanismes efficaces doivent être mis en place pour favoriser l’action multisectorielle en s’appuyant sur les données d’expérience et les enseignements tirés à l’échelle internationale. Le potentiel du secteur privé de la santé en faveur de la santé publique demeure inexploité. Cependant, le secteur privé n’est pas suffisamment réglementé pour garantir la qualité et prévenir les pratiques inappropriées. Dans plusieurs pays des groupes 2 et 3, il est en concurrence avec le secteur public pour la prestation des services de soins de santé primaires. Toutefois, son rôle n’est pas bien défini, ses capacités sont mal comprises et ses pratiques ne sont pas assez suivies. Très souvent, on manque d’informations sur beaucoup de ses fonctions, sur l’éventail des services qu’il fournit dans différents pays et sur la charge financière que supporte les utilisateurs de ces services. Sur la base de la résolution EM/RC59/R.3, un volet concernant le secteur privé a été ajouté au programme de travail du Bureau régional en 2013.
Pour ce qui est de la gouvernance, un certain nombre de missions consultatives ont eu lieu. Au Pakistan, une mission incluant de multiples partenaires a permis de formuler des recommandations au Gouvernement après la décision d’abolir le ministère de la Santé et de déléguer aux provinces les missions de ce secteur. Un examen approfondi du système de santé a été entrepris au Maroc après le récent amendement de la Constitution faisant de la santé un droit de l’homme. De même, diverses missions en Libye ont permis de faire l’examen détaillé du système de santé et d’évaluer les établissements de soins de santé primaires et les hôpitaux.
Dans plus de la moitié des pays de la Région, les activités concernant la politique sanitaire et la gouvernance se concentraient sur le renforcement des capacités et le soutien aux pays. Quatre profils de pays concernant le système de santé ont été mis à jour et quatre autres sont en cours de publication.
Systèmes d’information sanitaire
Les systèmes d’information sanitaire sont généralement faibles dans de nombreux pays et doivent être améliorés, notamment en termes de qualité et de rapidité des notifications. On observe des lacunes importantes dans l’ensemble des pays de la Région. Le recueil de données est fragmenté, avec des doublons fréquents, et les domaines clés liés au suivi de la situation sanitaire, des résultats en matière de santé et des performances du système de santé ne sont pas ou sont mal intégrés au système d’information sanitaire national. Plus précisément, il existe des lacunes majeures pour la notification de la mortalité par cause spécifique et des données des établissements de santé, la régularité des enquêtes de santé, les activités de recueil des données systématiques et d’autres données et la disponibilité des informations ventilées par âge, sexe, lieu ou catégorie socioéconomique. À cela s’ajoute le manque de ressources humaines formées à l’épidémiologie et aux systèmes d’information sanitaire. On constate aussi d’importants écarts dans les estimations régionales et nationales. Lors des discussions avec les États Membres, la coordination et le renforcement de celle-ci pour l’élaboration et l’établissement des estimations ont été identifiés comme les grandes priorités et feront l’objet d’une attention toute particulière en 2013.
Le renforcement des capacités en matière d’information sanitaire a également son importance pour la prise de décision, l’élaboration et l’évaluation des politiques et des plans. C’est ce que le Comité régional a souligné dans la résolution EM/RC59/R.3. L’enregistrement des faits et des statistiques d’état civil recevront une attention spécifique en 2012. L’enregistrement des naissances et des décès doit être renforcé dans la quasi-totalité des pays. Une évaluation rapide des systèmes d’enregistrement des faits et de statistiques d’état civil a été menée afin d’analyser la situation actuelle et d’identifier les lacunes ainsi que les priorités pour les améliorations. Les résultats montrent que ces systèmes sont insuffisants ou faibles dans près de 40 % des pays, et qu’ils sont satisfaisants dans seulement un quart des pays. Dans l’ensemble, ces systèmes ne desservent toutefois que 5,3 % de la population de la Région. Un bon système d’enregistrement des faits et de statistiques d’état civil permet de produire des données de qualité suffisante pour répondre, de manière satisfaisante, aux besoins pour l’élaboration des politiques, la prise de décision et le suivi de l’impact des interventions et des programmes de développement. Ces résultats ont permis de poser les jalons pour que soit menée une évaluation complète, en collaboration avec les partenaires concernés et les parties prenantes, comme première étape de la mise en œuvre des plans d’actions nationaux dans ce domaine.
Le Bureau régional a lancé un Observatoire régional de la santé, directement accessible depuis le site Web régional, dans le but de promouvoir la diffusion et l’utilisation des informations sanitaires. Cet observatoire, qui s’appuie sur plus de 40 bases de données et 800 indicateurs recueillis depuis 1990, est désormais la principale source d’informations sanitaires nationales.
En 2013, l’activité de l’OMS vise à formuler des orientations techniques sur les principales composantes des systèmes d’information sanitaire, notamment un consensus sur une liste essentielle d’indicateurs qui couvre les risques sanitaires et les déterminants de la santé, les résultats en matière de santé (morbidité et mortalité) ainsi que les performances du système de santé.
Développement des personnels de santé
La plupart des pays doivent développer leurs personnels de santé pour assurer l’équilibre et la motivation des effectifs, garantir une répartition et une gestion adéquates, et veiller à ce qu’ils possèdent la bonne combinaison de compétences. La densité globale des personnels de santé dans toute la Région est inférieure à la moyenne mondiale, qui est de 4 agents de santé qualifiés pour 1 000 habitants. Huit pays (l’Afghanistan, Djibouti, l’Iraq, le Maroc, le Pakistan, la Somalie, le Soudan et le Yémen) connaissent une crise en matière de ressources humaines pour la santé, qui est en grande partie due à des mesures insuffisantes pour faciliter l’entrée sur le marché, telles que par exemple le manque de préparation des personnels de santé par un investissement stratégique dans l’éducation et des pratiques de recrutement efficaces et éthiques. Les mauvaises performances des personnels de santé, du fait de l’absence de formation continue appropriée, et les mauvaises pratiques de gestion dans les secteurs public et privé constituent un autre défi. Les politiques pour la fidélisation des personnels de santé et la gestion des migrations et de la réduction naturelle des effectifs, qui visent à endiguer les pertes en ressources humaines, font également défaut malgré l’ampleur du problème.
Dans la Région, il est difficile d’assurer l’accès à une formation de qualité pour les personnels infirmiers, en raison d’importants obstacles : l’investissement insuffisant et le faible degré de priorité accordée à cette question ; le manque de capacités des écoles d’infirmières en termes de disponibilité des formateurs et d’infrastructures ; la nécessité de mettre à jour les programmes d’études afin de combler le décalage entre la formation et l’exercice des fonctions ; les capacités institutionnelles limitées concernant l’offre de programmes de formation supérieure ; et le manque d’importance accordée aux programmes de formation professionnelle continue.
Un observatoire des ressources humaines a été mis sur pied en Afghanistan et en Palestine pour aider au développement des personnels de santé. Le Bureau régional a encouragé l’utilisation de plusieurs instruments régionaux afin de renforcer les capacités pour la gouvernance et la planification des personnels, comme un guide pour l’accréditation des programmes des professions de la santé, ainsi que des outils visant à optimiser la charge de travail du personnel dans les établissements de santé et à établir des projections en la matière.
Dans le cadre des initiatives visant à renforcer la formation aux soins infirmiers et obstétricaux, plusieurs pays ont été soutenus pour l’élaboration de plans stratégiques nationaux. Le programme de formation au leadership et à la gestion, mis au point par le Conseil international des infirmières avec l’appui de l’OMS, s’est poursuivi dans plusieurs pays.
Actuellement, tous les pays ont des lacunes en matière de développement des personnels de santé, principalement pour ce qui concerne la production, la répartition, la formation, la formation continue et la fidélisation des effectifs, bien que la nature et l’ampleur de ces difficultés varient entre les pays. Pour combler ces lacunes et formuler des stratégies efficaces et réalisables dans ces domaines, il faudra mener un examen approfondi et analyser les expériences ainsi que les enseignements tirés à l’échelle régionale et internationale. Le développement des personnels de santé est une question qui réclame une attention accrue pour les deux prochaines années.
Prestation de services intégrés
De nombreux pays déploient des efforts pour mettre en place des programmes de médecine familiale efficaces comme principal moyen de fournir des soins de santé primaires et d’améliorer l’accès à ces services et la couverture de la population par ces derniers. La médecine familiale est un modèle de prestation de soins primordial, qui contribue à faire avancer la couverture sanitaire universelle. Les difficultés sont notamment le manque de médecins de famille, de personnels infirmiers et d’autres praticiens suffisamment formés, la mauvaise répartition des personnels de santé et l’engagement insuffisant des hôpitaux à apporter le soutien et l’appui nécessaires.
Il est nécessaire d’examiner les expériences et les enseignements tirés à l’échelle internationale et régionale, sur la base de modèles de médecine familiale réalistes, et d’élaborer des orientations sur les stratégies réalisables visant à renforcer la médecine familiale dans la Région. Ces questions seront le centre d’attention au cours de la période à venir.
Sécurité des patients et renforcement des systèmes de santé dans le cadre des initiatives mondiales en faveur de la santé
Pour continuer à soutenir la sécurité des patients, l’Initiative pour la sécurité des patients à l’hôpital a été étendue à d’autres pays. Le manuel d’évaluation de la sécurité des patients a été traduit en arabe et la seconde édition est en passe d’être achevée. Le guide multiprofessionnel pour la formation sur la sécurité des patients, élaboré par l’OMS, a été lancé ; plusieurs facultés de médecine ont commencé à l’intégrer au programme d’études. Des efforts sont en cours pour mettre au point un instrument visant à améliorer la sécurité des patients, qui fournisse des mesures pratiques et précise les actions requises pour concevoir un programme complet d’amélioration de la sécurité des patients.
Les obstacles à l’échelle du système, liés à l’accessibilité, à la disponibilité et à l’accessibilité financière des soins de santé, représentent un défi considérable dans la mise en œuvre des programmes de santé publique car ils nuisent à la prestation de services et aux performances des programmes. Les mauvaises performances des systèmes de santé posent également problème. En matière de gestion des systèmes de santé, une étude sur la décentralisation et une étude sur la gestion et l’évaluation des performances des hôpitaux ont été menées, respectivement dans dix et douze pays. Les résultats ont ensuite été diffusés.
Plusieurs États Membres ont bénéficié du renforcement des systèmes de santé dans le cadre d’initiatives mondiales en faveur de la santé comme l’Alliance GAVI, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ou le Partenariat international pour la santé (IHP+). En cinq ans, les fonds fournis par l’Alliance GAVI et le Fonds mondial pour renforcer les systèmes de santé s’élevaient respectivement à 160 millions et 120 millions de dollars US. Dans la plupart des pays, ces fonds transitent essentiellement par les gouvernements nationaux, l’OMS apportant un soutien technique pour l’élaboration de propositions de nouvelles opérations de financement, le suivi de la mise en œuvre et le renforcement des capacités. Les pays ayant utilisé ces fonds à bon escient ont fait d’importants progrès sur la voie du renforcement des systèmes de santé. Les performances varient cependant selon les pays et l’utilisation des fonds est parfois soumise à de lourdes procédures gouvernementales. Par ailleurs, trois autres pays ont signé le Pacte d’IHP+. Il ne s’agit pas d’une initiative de financement, mais elle encourage les pays et les partenaires à s’accorder sur un plan sanitaire national. Le degré d’engagement dont les pays ont fait preuve pour le Partenariat IHP+ est variable.
Nombre de pays connaissent des situations d’urgence complexes. Or, la plupart des systèmes de santé sont mal préparés à y répondre et ne sont pas résilients face aux situations d’urgence prolongées. Ces pays doivent être soutenus afin de renforcer leurs capacités en matière de collaboration, de coordination, de planification, de communication et d’échange d’informations.
Technologies et médicaments essentiels
L’accès aux technologies essentielles (médicaments, vaccins, produits biologiques et dispositifs médicaux) est insuffisant dans la majorité des pays des groupes 2 et 3, et l’usage non rationnel est répandu. Il existe des autorités nationales de réglementation dans presque tous les pays, mais leurs performances doivent être améliorées. La plupart d’entre elles se concentrent sur la réglementation des médicaments et non sur celle des produits biologiques, dispositifs médicaux et technologies cliniques, notamment des laboratoires. La gestion de la qualité, la surveillance du secteur privé et la protection des biens publics vis-à-vis des intérêts commerciaux sont faibles et doivent être considérées attentivement.
Dans le domaine des technologies essentielles, les profils pharmaceutiques de six pays ont été établis, les documents de la politique pharmaceutique nationale ont été mis à jour pour deux
pays (le Maroc et le Yémen) et cinq autres pays ont rejoint le programme de bonne gouvernance dans le secteur pharmaceutique. Les rapports des évaluations nationales de la transparence sur la vulnérabilité du secteur pharmaceutique à la corruption ont été préparés pour trois pays. En outre, un appui a été fourni à plus de dix autorités nationales de réglementation pour les inspections sur les bonnes pratiques de fabrication.
Le renforcement des capacités a permis d’améliorer la coordination entre les responsables de l’élaboration des politiques et les organismes de réglementation en ce qui concerne l’usage rationnel et l’évaluation des vaccins, comme par
exemple le vaccin antidiphtérique-antitétanique-anticoquelucheux (DTC) et le vaccin
combiné DTC, ainsi que les systèmes pour l’innocuité des vaccins. L’Afghanistan, le Soudan et le Yémen ont reçu un soutien pour améliorer leurs systèmes de pharmacovigilance vaccinale.
En matière de technologie de la santé et de dispositifs médicaux, des missions ont été menées dans plusieurs pays pour évaluer les infrastructures et la gestion des technologies sanitaires. En collaboration avec le Siège de l’OMS, une deuxième série a été lancée dans le cadre de l’enquête mondiale sur les dispositifs médicaux. Plus de 70 % des États Membres y ont participé, contre 40 % lors de la première série. D’après les résultats, seulement 5 % des États Membres de la Région ont mis en place des politiques et des unités de coordination pour les dispositifs médicaux, 29 % disposent de systèmes de réglementation et d’inventaire, et 16 % ont élaboré des lignes directrices nationales pour l’approvisionnement et la maintenance. En 2013, une réunion de consultation interpays sera organisée dans ce domaine d’action.
|
|
Renforcement des systèmes de santé en vue de la couverture sanitaire universelle |
 |
 |
Couverture sanitaire universelle
En 2014, l'OMS s'est attachée à fournir aux États Membres un appui technique pour la mise en œuvre des engagements souscrits dans les résolutions EM/RC59/R.3 (2012) et EM/RC60/R.2 (2013) du Comité régional. Un cadre d'action pour progresser vers la couverture sanitaire universelle et faire le lien entre les divers engagements pris a reçu un soutien lors de la soixante et unième session du Comité régional en octobre 2014.
Financement de la santé
Des stratégies de financement de la santé fondées sur des données probantes et propres au contexte sont essentielles pour atteindre l'objectif de la couverture sanitaire universelle. Le manque d'informations sur les dispositions d'ordre institutionnel et organisationnel des systèmes de financement de la santé ainsi que sur l'apport de fonds dans plusieurs pays de la Région sape les efforts visant à élaborer des stratégies de financement reposant sur des bases factuelles. Par ailleurs, l'expertise nationale limitée en matière de financement de la santé en général, et en ce qui concerne les dispositions spécifiques du financement de la santé en particulier, telles que le régime de protection sociale, est absolument essentielle pour aller de l'avant.
L'appui de l'OMS à l'élaboration de stratégies de financement de la santé comprenait le renforcement des capacités nationales en matière de production d'informations quantitatives et qualitatives, en suivant respectivement les comptes nationaux de la santé ainsi que l’analyse organisationnelle en vue de l’amélioration et du renforcement du financement de la santé (OASIS). L’orientation de l’assistance technique est passée du plaidoyer en faveur du financement de la santé au développement des compétences dans des domaines tels que la mise en place des systèmes de sécurité sociale, les achats stratégiques et la participation de différents secteurs ainsi que la couverture sanitaire universelle, et ce, par l’organisation de consultations régionales et l’élaboration des documents de politiques. On observe actuellement le développement des compétences d’un groupe d’experts et de chercheurs dans les domaines de la mesure de la protection contre les risques financiers, dans le cadre du suivi des progrès vers la couverture sanitaire universelle, ainsi que dans la réalisation des études d’évaluation économique.
Un appui technique au niveau national a été fourni à plusieurs pays pour formuler une vision, une stratégie et une feuille de routes nationales en vue de progresser vers la couverture sanitaire universelle. Plusieurs études diagnostiques concernant les différentes fonctions du financement de la santé ont été réalisées au préalable.
En 2015, les activités continueront d'être axées sur les interventions clés en vue de progresser vers la couverture sanitaire universelle, qui incluront notamment une vision, une stratégie et une feuille de route nationales pour la couverture sanitaire universelle pleinement intégrées au cadre politique national ; le développement des systèmes d’assurance maladie et l’élargissement de la protection financière aux groupes informels et vulnérables de la population et la réduction des paiements directs.
Gouvernance de l’action sanitaire et droits de l’homme
Des politiques, des stratégies et des plans fondés sur des bases factuelles constituent les éléments essentiels pour progresser vers la couverture sanitaire universelle. La plupart des pays ne disposent pas des capacités suffisantes au sein de leur ministère de la Santé pour formuler ce type de politiques et de plans stratégiques et ont un accès limité aux données de qualité permettant d'éclairer l'élaboration de politiques et de stratégies. Par ailleurs, leur utilisation de ces données est également limitée. L'instabilité politique actuelle et les crises sociales auxquelles on assiste dans une grande partie de la Région ainsi que l'alignement et l'harmonisation limités entre les partenaires de développement en appui à un plan sanitaire national unique, constituent certains des défis supplémentaires auxquels sont confrontés de nombreux pays des groupes 2 et 3 1.
Les efforts en cours pour évaluer la situation concernant la planification sanitaire dans les pays ont permis d’avoir une idée plus précise de l’ensemble des atouts et des faiblesses qui caractérisent les ministères de la Santé et des difficultés que ces derniers rencontrent en matière de politiques et de planification sanitaires. Dans un effort visant à de renforcer les capacités des bureaux de pays de l'OMS pour aider les pays dans leurs processus de formulation et de planification des politiques de santé nationales, de hauts responsables de l’OMS ont participé à des séminaires-ateliers sur la planification sanitaire stratégique, organisés en collaboration avec la Nuffield School of Public Health et le Centre for International Development de l'Université de Leeds au Royaume-Uni. Il est prévu de renforcer les capacités nationales en matière de planification sanitaire stratégique et de réglementation du secteur de la santé, ainsi que d’examiner, dans certains pays, la situation relative aux efforts de coordination entre les partenaires de développement et l'efficacité de l’aide extérieure.
La Région est depuis longtemps confrontée à des défis en ce qui concerne l’égalité entre les sexes, l'équité et les droits humains en santé. Les conflits prolongés, les niveaux croissants de pauvreté, les degrés variables d'inégalité et l'existence de groupes vulnérables et marginalisés constituent des facteurs sous-jacents importants. Il manque toujours des données ventilées ainsi qu'une évaluation de la vulnérabilité permettant d'éclairer les politiques de santé publique et de guider les actions dans une optique de droits de l'homme.
Un examen des données factuelles et des lacunes existantes ainsi que les efforts de plaidoyer continus ont permis une meilleure intégration des questions d'égalité entre les sexes, d'équité et de droits humains dans l'ensemble des activités de l'Organisation. Un cours sur la santé et les droits de l'homme a été mis au point et testé en Égypte, en collaboration avec l'Université américaine du Caire. Ce cours a fait l’objet d’une évaluation externe, et il est actuellement réalisé au Pakistan. Il sera proposé à d’autres pays en 2015.
La législation de santé publique doit être révisée et il est également nécessaire de développer les capacités des ministères en matière de formulation, de mise en œuvre et de suivi de la législation. Un examen de la situation et des capacités pour la réglementation du secteur privé de la santé a été réalisé dans quatre pays et un manuel est en préparation en collaboration avec le Siège de l’OMS.
Au cours de 2015, une attention particulière sera accordée au renforcement des capacités des ministères de la Santé en matière de planification stratégique par la formation du personnel national et la fourniture de conseils faciles à suivre en vue de l’élaboration de plans stratégiques efficaces. On s’intéressera au renforcement des capacités en matière de législation sanitaire, de réglementations, d’établissement des normes et de surveillance de l’application en mettant l’accent sur le secteur privé. L’efficacité de l’aide extérieure et de l’état des flux d’aides dans les pays, notamment ceux qui font face à des situations de conflit, sera évaluée.
Suite à la demande des États Membres, l’OMS a lancé une initiative régionale en 2013 en vue d’évaluer les capacités de santé publique dans les pays, par l’identification des fonctions de santé publique essentielles adaptées au contexte de la Région. En 2014, deux évaluations de pays ont été menées, au Qatar et au Maroc, avec le soutien de l’OMS et d’une équipe d’experts dans le domaine de la santé publique internationale. Grâce à cette évaluation, les pays, sous la houlette de leurs ministères de la Santé, sont maintenant capables d’identifier les points forts dans leurs systèmes de santé publique ainsi que les domaines qui nécessitent davantage de renforcement. En mai 2015, l’OMS a mobilisé un petit groupe d’experts de la santé publique internationale et des représentants des deux pays qui ont mené cette évaluation en vue d’analyser l’expérience, d’examiner l’outil et d’améliorer le processus d’évaluation et de suivi. Actuellement, les outils d’évaluation sont révisés en vue de les rendre plus faciles à utiliser ; l’initiative sera ensuite étendue à d’autres pays.
Développement des personnels de santé
La situation des personnels de santé continue de refléter les tendances mondiales eu égard aux pénuries d’effectifs, à la répartition inéquitable, à la fidélisation et aux performances des personnels. La densité globale des personnels de santé est sous-optimale et la mauvaise répartition, la fidélisation et la migration de ces personnels ainsi que la dépendance excessive par rapport aux personnels de santé expatriés représentent d’importants défis qui entravent les progrès vers la couverture sanitaire universelle dans de nombreux pays. Le manque de capacités institutionnelles pour la planification des personnels de santé nationaux représente un autre obstacle et les sources d'informations sont insuffisantes.
Alors que les lacunes en matière de développement des personnels de santé sont manifestes, les solutions pour y remédier ne le sont pas toujours. Afin de relever ce défi, un cadre stratégique régional pour les personnels de santé a été élaboré, suite à un examen critique réalisé par un groupe d'experts internationaux ainsi que l’organisation d’une réunion de consultation régionale visant à faire avancer le programme d’action pour les personnels de santé. Le cadre sera aligné sur la stratégie mondiale sur les personnels de santé actuellement en cours d'élaboration par le Siège de l'OMS et l'Alliance mondiale pour les personnels de santé.
Après une pause de près de 20 ans, le domaine de l’éducation médicale a été réexaminé et une enquête en ligne complète a été menée et ciblait plus de 300 écoles de médecine. Entre autres, l'enquête a confirmé la progression vers la privatisation de l'enseignement médical tout en faisant apparaître une réglementation insuffisante, le manque de systèmes d'accréditation, des programmes centrés sur l’enseignant et l'utilisation de méthodes d'évaluation traditionnelles qui ne sont liées ni aux acquis d'apprentissage ni aux compétences. Les résultats ont été présentés lors d'une réunion des responsables régionaux et internationaux de l'éducation médicale. Une feuille de route a été élaborée pour aider les écoles de médecine à augmenter leur responsabilité sociale, à adopter une orientation davantage communautaire et à accroître l’accréditation, dans le cadre de l’appui à la couverture sanitaire universelle. Le thème de l’éducation médicale sera examiné par le Comité régional lors de sa soixante-deuxième session, suite à quoi les pays devront adapter le cadre d’action régional sur la base des priorités nationales.
Il est actuellement prévu de mener un examen complet de la situation des soins infirmiers et obstétricaux dans les pays de la Région. Cet examen vise à fournir des orientations stratégiques claires fondées sur des mesures pratiques, réalisables et sur des données probantes, et reposant sur des informations fiables et les bonnes pratiques.
Un appui technique a été apporté à l'Organisation arabe pour le développement administratif de la Ligue des États arabes dans le cadre de la conférence sur la migration des personnels de santé. Le Bureau régional a participé à la neuvième réunion annuelle de l'Association internationale des instituts nationaux de santé publique, qui s'est tenue pour la première fois dans la Région de la Méditerranée orientale. Une réunion spéciale des instituts régionaux de santé publique a été organisée dans le but d'encourager la mise en réseau et l'élaboration de programmes de collaboration pour renforcer la santé publique dans la Région.
Le programme de bourse d'études a continué à aider les pays à renforcer les capacités nationales dans les cinq domaines prioritaires régionaux ; 74 bourses d'études ont en effet été attribuées dans la Région. Le programme a été fortement impliqué, en collaboration avec la Harvard School of Public Health, dans l'organisation du Programme de leadership pour la santé. Ce dernier sera lancé début 2015 avec pour objectif de former les futurs hauts responsables de la santé publique qui seront en mesure de s'attaquer de manière proactive aux questions de santé à l'échelle nationale et locale qui ont des répercussions directes sur la santé de la population et de jouer un rôle actif dans le contexte de la santé publique mondiale. Le programme a été réalisé en deux parties, à Genève et à Mascate, et les deux parties ont été hautement appréciées par les participants et les animateurs. Compte tenu du succès initial et de la forte demande, la deuxième édition du programme commencera en novembre 2015.
En 2015, une importance particulière sera accordée à l’aide apportée aux pays pour élaborer des plans d'action et des stratégies pour les personnels de santé au niveau national, et pour mettre en œuvre les stratégies en vue de développer l'enseignement de la médecine ainsi que des soins infirmiers et obstétricaux. Parmi les nouvelles initiatives, on compte une évaluation de la formation professionnelle continue des médecins et l'amélioration de la notification des pays concernant l'application du Code pratique mondial de l'OMS pour le recrutement international des personnels de santé.
Technologies et médicaments essentiels
Les profils de pays pour le secteur pharmaceutique établis au cours de 2014 ont mis en évidence des lacunes dans des domaines essentiels concernant les autorités de réglementation pharmaceutique. Ces lacunes concernaient notamment les structures organisationnelles et les capacités techniques, les politiques pharmaceutiques nationales, la transparence et la redevabilité en matière de réglementation et d’approvisionnement des produits médicaux, les mécanismes visant à endiguer la résistance aux antimicrobiens, la promotion/publicité en faveur des produits médicaux ainsi que l’accès aux médicaments sous contrôle, y compris les médicaments destinés à prendre en charge la douleur.
Des approches permettant de renforcer les moyens réglementaires relatifs aux médicaments et aux dispositifs médicaux ont fait l'objet de discussions lors de la Conférence des autorités de réglementation pharmaceutique de la Méditerranée orientale qui s'est tenue en mai 2014. Avant la conférence, une enquête menée auprès de 17 autorités de réglementation nationales a révélé que la majorité des autorités (80 %) avaient en place les principales fonctions de réglementation et que toutes étaient chargées de l'enregistrement des produits médicaux. Seules 40 % des autorités de réglementation nationales procèdent à l'enregistrement accéléré des médicaments présélectionnés par l'OMS tandis que 80 % procèdent à l'enregistrement accéléré des vaccins.
L’action a progressé en matière de bonne gouvernance dans le secteur pharmaceutique dans 16 pays. Lors d'une réunion régionale, l'accent a été mis sur la gestion des conflits d'intérêts en tant que question prioritaire des politiques de gouvernance. Le programme de bonne gouvernance dans le secteur pharmaceutique dans la Région est le plus développé de toutes les régions de l'OMS. En effet, six pays se trouvent actuellement en phase I de ce programme ; sept sont passés à la phase II et trois à la phase III. Les profils du secteur pharmaceutique actualisés de chaque pays ont révélé que l'accès aux médicaments sous contrôle pour la prise en charge de la douleur et le traitement des troubles mentaux demeure très limité et par conséquent, les patients souffrent alors qu'ils ne devraient pas.
Des progrès ont été réalisés en matière d'évaluation, de réglementation et de gestion des technologies de la santé avec la création du Réseau d’évaluation des technologies de la santé de la Région de la Méditerranée orientale en vue de l'échange d'informations et du partage des connaissances. Il s'agit d'un des résultats de la deuxième réunion interpays sur le développement de l'évaluation des technologies de la santé au niveau national. Une enquête régionale a été réalisée pour cartographier les ressources d’évaluation des technologies de la santé. Cette enquête qui ciblait les responsables et les défenseurs des technologies de la santé dans 15 pays a montré que 52 % des entités régionales réalisent des activités assimilées à l’évaluation ayant trait principalement à la mesure de l’efficacité clinique et l’évaluation économique des dispositifs médicaux et des médicaments. L’enquête a indiqué la nécessité de réorganiser et/ou d’initier des activités d’évaluation dans la Région afin d’effectuer des investissements rationnels dans des technologies de la santé qui sont accessibles à la majorité de la population.
En 2014, l’OMS a présélectionné les deux premiers produits médicaux fabriqués par une entreprise pharmaceutique locale en Égypte et le premier laboratoire de contrôle de la qualité des médicaments dans le secteur privé au Pakistan. Des laboratoires nationaux de contrôle de la qualité des médicaments dans deux autres pays sont en voie d’être présélectionnés par l’OMS. En 2015, l'accent portera sur la mise en œuvre des résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé consacrées au renforcement des systèmes de réglementation des produits médicaux, y compris le renforcement de la pharmacovigilance. La notification des produits médicaux contrefaits sera renforcée. Conformément au plan d'action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens, un appui sera apporté aux pays pour l'élaboration de plans nationaux visant à renforcer la surveillance de la résistance aux antimicrobiens et leur usage responsable.
Prestation de services intégrés
La plupart des pays de la Région sont engagés en faveur du renforcement de la médecine familiale. Toutefois, le niveau de mise en œuvre est inégal et incohérent. Une évaluation de la situation de la médecine familiale a révélé des lacunes importantes ayant trait à l'engagement politique, à l'enregistrement des patients, aux dispositifs de services de santé essentiels, aux listes de médicaments essentiels, aux systèmes d’orientation-recours et aux personnels. Le nombre insuffisant de médecins de famille formés ainsi que l'incapacité des programmes actuels à répondre aux besoins considérables constituent un autre défi important à relever.
Un manque de soins de santé primaires de qualité ainsi que l'expansion anarchique du secteur privé de la santé dans la plupart des pays des groupes 2 et 3 constituent des défis supplémentaires. Les hôpitaux du secteur public consomment une proportion significative des budgets de la santé, ne satisfont pas aux normes de qualité et de sécurité dans plusieurs pays ; et dans d’autres pays, on note qu'ils dépendent de plus en plus des paiements des usagers. De manière générale, les hôpitaux ne sont pas intégrés au système de santé et n'offrent pas d'appui en termes d'orientation-recours.
La médecine familiale a été encouragée en tant qu'approche principale pour parvenir à des services intégrés centrés sur la personne. Une analyse de la situation visant à faire un état des lieux des programmes de médecine familiale et de formation des médecins de famille a été présentée lors de la consultation régionale organisée en collaboration avec l'Organisation mondiale des Médecins de Famille. Les résultats d’une analyse de la situation menée en 2014 ont révélé que la majorité des pays ont développé un ensemble de services essentiels, et qu’un peu plus de la moitié de ces pays le mettent en œuvre actuellement ; un système d’enregistrement des patients et de classification par famille/individu est pratiqué dans la moitié des pays, et le système d’orientation-recours est partiellement ou complètement opérationnel dans cinq pays. Cependant, plus de 90 % des médecins travaillant dans des établissements de soins primaires ne sont pas formés à la médecine familiale. Des services de médecine familiale sont disponibles dans 13 pays et le nombre des médecins de famille formés annuellement est de 700, dont la majorité font partie des pays du groupe 1.
Une feuille de route a été élaborée pour renforcer la prestation de services et celle-ci est alignée sur le cadre d'action pour progresser vers la couverture sanitaire universelle. Durant 2015, l’action menée pour développer la médecine familiale en tant qu’approche principale des soins de santé intégrés centrés sur la personne continuera à être encouragée. Une tâche particulière consistera à partager les données disponibles sur l’intensification de la production de médecins de famille à court et moyen termes.
Plusieurs études ont également été menées afin de mieux comprendre le secteur privé de la santé, notamment une évaluation de la qualité et du coût des soins dans le secteur privé de la santé dans six pays et de la situation concernant la réglementation du secteur privé dans deux pays ainsi qu'un bilan des enseignements tirés du partenariat public-privé. Ces études ont été présentées lors d'une consultation régionale qui a abouti à l'identification d'un certain nombre de priorités ayant trait à la collaboration avec le secteur privé.
Une consultation régionale sur la qualité et la sécurité des soins dans les pays de la Région, a été organisée en collaboration avec le Central Board for Accreditation of Healthcare Institutions [Office central d’accréditation des institutions de soins de santé] en Arabie saoudite. Le manuel d'évaluation de la sécurité des patients, publié en 2011, a été mis à jour et testé sur le terrain dans deux pays. De plus, un manuel pour la sécurité des patients a été mis au point. Un cadre d'évaluation et d'amélioration de la qualité au niveau des soins de santé primaires est actuellement à l’essai. Le renforcement des capacités sera intensifié dans les domaines de la sécurité des patients et de la qualité, de l’évaluation, de la réglementation et des partenariats avec le secteur privé de la santé et de la gestion et des soins hospitaliers.
La gestion et les soins hospitaliers représentent un nouveau domaine qui fait l’objet d’une attention accrue. L'accent a été mis sur la mise au point d'une analyse complète de la situation des hôpitaux du secteur public dans la Région. Un cours sur la gestion hospitalière a été proposé aux pays qui font face à des situations de conflit, en collaboration avec l'Université Aga Khan de Karachi. Le cours est en train d’être actualisé et sera ensuite lancé dans la Région.
Un appui technique a été fourni aux pays éligibles pour soumettre des nouvelles candidatures en vue d’obtenir un financement de GAVI, l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination ; le montant de ce soutien s’élèvera à USD 85 millions. Parallèlement, des séminaires-ateliers sur le renforcement des capacités des systèmes de santé ont été menés en vue de développer les compétences des responsables des programmes dans ces pays.
Systèmes d’information sanitaire
Des travaux approfondis ont eu lieu dans le cadre de l'examen des systèmes d’information sanitaire de la Région, par le biais de consultations d'experts, de réunions interpays ainsi que d’évaluations rapides et exhaustives. Ceci a permis d’identifier des lacunes et des défis, et de mettre au point une approche pour renforcer les systèmes d'information sanitaire nationaux. Le cadre régional pour les systèmes d'information sanitaire ainsi que les indicateurs de base qui en ont résulté et qui ont été approuvés par le Comité régional (EM/RC61/R.1) fourniront des orientations claires aux pays. Le cadre régional pour les systèmes d’information sanitaire et les indicateurs de base couvre trois domaines : les risques sanitaires et les déterminants de la santé, la situation sanitaire et la performance des systèmes de santé.
L'accent mis sur le renforcement des statistiques par cause spécifique de mortalité, tel que recommandé dans la stratégie régionale visant à renforcer les systèmes d’enregistrement des actes et de statistiques d'état civil approuvée par le Comité régional en 2013, s'est traduit par une augmentation du nombre de pays notifiant des statistiques de mortalité, passant de sept pays (Bahreïn, Égypte, Jordanie, Koweït, Maroc, Oman et Qatar) à 12 pays (en y ajoutant l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la République islamique d’Iran, la Palestine et la Tunisie). La qualité des informations notifiées s'est quelque peu améliorée ; toutefois il reste des progrès à faire pour parvenir à une qualité optimale. Un centre collaborateur de l'OMS a été instauré au Koweït pour soutenir la poursuite de l'amélioration des statistiques de mortalité ainsi qu'une meilleure utilisation de l'ensemble des classifications internationales de l'OMS.
Dans les deux prochaines années, l'OMS est attachée à apporter un soutien aux États Membres dans leurs efforts visant à renforcer leurs systèmes d'information sanitaire, sur la base du nouveau cadre d’action, et à fournir des informations fiables qui leur permettront d'effectuer un suivi des déterminants de la santé et des risques sanitaires, de la situation sanitaire, et d'évaluer la réponse du système de santé, qui en retour guidera l'élaboration des politiques et la prise de décisions en vue de l'amélioration de la prestation de soins de santé. L’OMS continuera par ailleurs à fournir un appui aux États Membres pour combler les lacunes existantes dans leurs systèmes d’enregistrement des faits et de statistiques d’état civil, qui ont été mis à jour par les évaluations rapides et complètes réalisées ces deux dernières années.
Recherche, développement et innovation
Une réunion régionale a été organisée pour les États Membres du Comité consultatif de la recherche en santé de la Méditerranée orientale et pour des experts en recherche afin de discuter de l'intégration de la recherche dans les travaux réalisés dans les domaines prioritaires identifiés afin de concevoir l’avenir de la santé dans la Région. La réunion a porté principalement sur l’identification des priorités de recherche liées aux cinq priorités stratégiques régionales. Cet exercice devrait se conclure en janvier 2016 et les résultats orienteront les activités de recherche pour la période 2016–2017. L'appel à propositions pour la subvention spéciale de recherche dans les domaines prioritaires de santé publique pour 2014 était également centré sur ces priorités stratégiques. Douze subventions allant de 10 000 dollars US à 20 000 dollars US ont été attribuées début 2015.
|
|