|
Promouvoir la santé tout au long de la vie |
 |
 |
Santé maternelle, génésique et infanto-juvénile
Ces vingt dernières années, la Région a progressé dans le combat qu’elle mène contre les décès évitables de mères et d’enfants. Entre 1990 et 2011, la mortalité des moins de cinq ans a chuté de 41 % dans la Région (Figure 2) et, entre 1990 et 2010, la mortalité maternelle a diminué de 42 % (Figure 3). Cependant, le problème reste de taille. On estime que, chaque année, 923 000 enfants de moins de cinq ans et près de 39 000 femmes en âge de procréer meurent toujours dans la Région. Les taux de mortalité maternelle et infanto-juvénile sont particulièrement élevés dans les régions pauvres, sont rurales et mal desservies, chez les enfants souffrant de malnutrition et les adolescentes enceintes. Certains pays ont déjà réalisé les objectifs du Millénaire pour le
développement 4 et 5, mais il reste d’importants efforts à faire pour accélérer les progrès et faire passer le taux moyen de réduction annuelle de la mortalité maternelle de 2,6 % à 16,8 %, et celui pour la mortalité infantile de 2,5 % à 14 %, afin de réaliser ces objectifs dans la Région d’ici 2015.
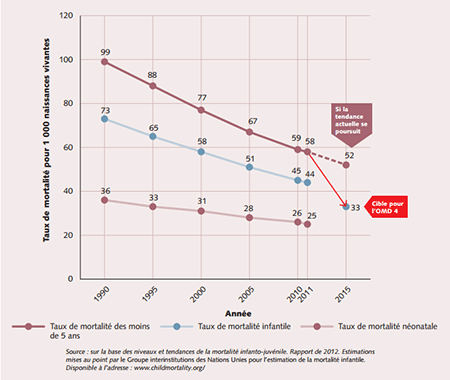
Figure 2.Tendance de la mortalité des moins de cinq ans, y compris la mortalité infantile et néonatale, 1990-2011 et extrapolation d’ici à 2015
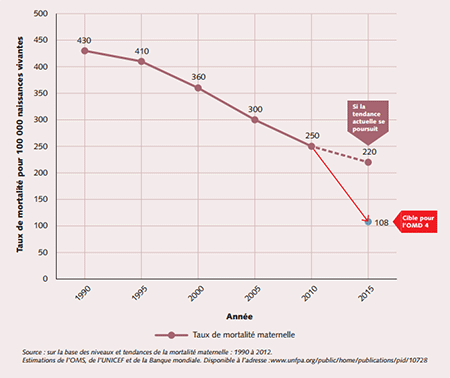
Figure 3.Tendance de la mortalité maternelle pour 1990-2010 et extrapolation d’ici à 2015
Face aux décès inacceptables qui touchent les catégories vulnérables de la population, et alors que la santé de la mère et de l’enfant est censée être au cœur du développement, les tendances actuelles indiquent que certains pays n’accordent pas un degré de priorité suffisant à la réduction de ce fardeau. Dans ces pays, le manque et les inégalités d’accès aux services de santé maternelle et infanto-juvénile demeurent problématiques, en plus du renouvellement rapide du personnel et de l’absence de plan national intégré pour la santé de la mère et de l’enfant. La faiblesse des progrès s’explique par l’instabilité politique, l’insuffisance des ressources financières pour améliorer la couverture par des interventions efficaces et le manque de données de qualité pour une gestion des programmes fondée sur des bases factuelles, notamment dans les pays qui connaissent des situations d’urgence humanitaire, des conflits violents et des déplacements de population. Face à cette situation, le Comité régional a fait de la santé de la mère et de l’enfant une priorité stratégique dans la Région. La stratégie adoptée par le Bureau régional repose sur les trois éléments suivants : l’attention particulière accordée aux pays où la charge de la mortalité maternelle et infanto-juvénile est élevée, dans le cadre du soutien technique de l’OMS ; l’importance des interventions ayant un bon rapport coût-efficacité et un fort impact en matière de soins de santé primaires ; et les partenariats renforcés. Ce dernier élément signifie que les
programmes OMS relatifs à la santé de la mère et de l’enfant et les autres programmes, comme ceux qui concernent les systèmes de santé, la lutte contre les maladies transmissibles et la vaccination, doivent travailler davantage ensemble et que des efforts particuliers doivent être fournis pour renforcer la coordination et les activités communes avec les autres partenaires, notamment l’UNICEF, l’UNFPA et d’autres organismes qui n’appartiennent pas au système des Nations Unies. Un groupe régional d’experts en santé maternelle et infanto-juvénile s’est constitué en
septembre 2012 pour soutenir le Bureau régional et les États Membres. Ce groupe d’experts s’est ensuite réuni afin de définir, dans les grandes lignes, les orientations stratégiques pour la santé de la mère et de l’enfant dans la Région et de soutenir les pays pour l’élaboration de plans visant à accélérer les efforts.
Vers la fin de l’année, un travail important a été accompli en préparation de la réunion de haut niveau pour sauver les vies des mères et des enfants, qui s’est tenue début 2013. Les éléments des plans d’action nationaux ont été discutés et exposés sous la forme d’interventions fondées sur des bases factuelles, ayant un bon rapport coût-efficacité et visant à accélérer le recul de la mortalité maternelle et infanto-juvénile. Un séminaire-atelier technique a permis d’analyser en profondeur les lacunes et les défis actuels, et de partager les informations et les données d’expérience sur les progrès effectués par rapport aux objectifs du Millénaire pour le
développement 4 et 5 ainsi que dans l’analyse des politiques nationales pour la santé de la mère et de l’enfant de dix pays prioritaires, où la charge de la mortalité maternelle et infanto-juvénile est élevée. Ces pays sont l’Afghanistan, Djibouti, l’Égypte, l’Iraq, le Maroc, le Pakistan, la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud et le Yémen. Ce séminaire-atelier était organisé à la suite d’une mission d’envoyés spéciaux dans les pays prioritaires, dont le but était de préconiser et de susciter un engagement national accru et une participation active des pays à l’élaboration des plans d’accélération.
Le Bureau régional a également joué un rôle actif pour le lancement des activités de la Commission sur l’information et la redevabilité dans les dix pays prioritaires. En septembre 2012 s’est tenu un séminaire-atelier régional auquel les délégations des dix pays ont participé. Sept d’entre eux ont ensuite bénéficié d’un soutien pour organiser des séminaires-ateliers nationaux, qui ont permis d’élaborer des feuilles de route pour renforcer, au niveau national, la responsabilisation et l’action afin d’améliorer la santé de la femme et de l’enfant.
Comme le conseil est une composante clé pour améliorer la qualité des soins et leur impact sur la santé publique, le Bureau régional, en collaboration avec l’UNFPA, s’est attaché à mettre en place des équipes régionales et nationales de formateurs dans le domaine du conseil en santé maternelle et génésique. La stratégie de la prise en charge intégrée de la santé de l’enfant (PCIME) est utilisée dans 72 % des établissements de soins de santé primaires de treize pays. Le Bureau régional continue à soutenir l’évaluation de la qualité de l’enseignement et des résultats des étudiants dans les facultés de médecine ayant intégré cette stratégie à leur programme d’études. Une initiative visant à augmenter la couverture par les interventions a été lancée dans certains pays.
Pour l’année 2013, le défi consiste à parachever, à lancer et à mettre en œuvre les plans d’accélération visant à intensifier l’action en vue de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 4 et 5 d’ici 2015.
Nutrition
Le Bureau régional a fourni un appui technique pour l’élaboration de politiques et la mise en œuvre de la stratégie régionale ainsi que du plan d’action sur la nutrition dans de nombreux pays. Toutefois, la plupart des pays n’ont pas de politiques ou de plans opérationnels et multisectoriels en matière d’alimentation et de nutrition. De plus, la coordination entre les politiques agricoles et sanitaires est généralement faible. La prise en charge de la malnutrition sévère a été instaurée dans trois pays (l’Afghanistan, le Pakistan et le Yémen) grâce au soutien fourni pour la création de plus de soixante unités de formation et de stabilisation nutritionnelle dans les principaux hôpitaux et centres de santé pédiatriques. Le Bureau régional, en collaboration avec le Siège de l’Organisation, a soutenu le renforcement des capacités régionales afin d’appliquer les nouvelles lignes directrices de l’OMS pour la prise en charge de la malnutrition sévère et de faciliter l’actualisation des protocoles et plans d’action nationaux en la matière. Les recommandations régionales sur l’enrichissement des farines de blé et de maïs en vitamines et minéraux ont été examinées conjointement avec l’Initiative pour l’enrichissement de la farine, l’Alliance mondiale pour l’amélioration de la nutrition, l’Initiative pour les micronutriments, l’UNICEF et le Programme alimentaire mondial, afin qu’elles soient conformes aux recommandations de l’OMS. Certains pays ont également été conseillés pour le renforcement des systèmes de surveillance nutritionnelle.
Vieillissement et santé dans certains groupes
De manière générale, les États Membres connaissent de grandes difficultés en ce qui concerne l’engagement pérenne en faveur des programmes pour le vieillissement en bonne santé. Ils ont également des lacunes au niveau de la préparation des systèmes de santé pour répondre aux besoins croissants des populations vieillissantes, et de la disponibilité de personnels de santé ayant une formation appropriée et présentant l’expertise attendue dans ce domaine. Certains progrès ont néanmoins été accomplis en 2012 en matière de collaboration technique avec les États Membres.
Des missions d’évaluation ont eu lieu en République islamique d’Iran, en Jordanie et en République arabe syrienne. Les conclusions ont attesté de progrès incontestables et d’un engagement pour le renforcement des politiques et des programmes. Les initiatives pour les villes et communautés-amies des aînés ont été soutenues dans trois pays (Bahreïn, Jordanie et République arabe syrienne). Une mise à jour du guide régional sur les soins de santé aux personnes âgées à l’intention des agents de santé de soins de santé primaires a été préparée, en plus d’un guide procédural et d’un guide du facilitateur. Un outil électronique régional a été mis au point pour recueillir des données sur le vieillissement et la santé. Plusieurs pays ont élaboré et actualisé leur stratégie nationale pour le vieillissement actif et en bonne santé et les soins aux personnes âgées. L’Arabie saoudite a élaboré un document de stratégie nationale et des lignes directrices mises à jour sur les soins de santé pour les personnes âgées. En outre, Oman a été le premier pays à concevoir un programme unique pour les services de soins aux personnes âgées.
Violence, traumatismes et incapacités
En 2012, l’OMS a fait de la prévention des traumatismes un programme prioritaire dans la Région, en réservant une attention particulière aux traumatismes dus aux accidents de la circulation et aux soins de traumatologie. Un plan quinquennal régional (2012–2016) visant à réduire ce type de traumatismes a vu le jour en collaboration avec les experts régionaux et internationaux. Dix-neuf pays ont établi les données de base pour le Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde 2013. Un instrument régional a permis de recueillir des données sur les activités nationales en matière de sécurité routière menées dans treize pays. Des séminaires-ateliers pour le renforcement des capacités ont eu lieu dans seize pays, à l’intention des professionnels de la santé publique dans les domaines de la prévention de la violence et des traumatismes et de l’épidémiologie des traumatismes. La prévention des traumatismes a été intégrée aux programmes d’études en santé publique, médecine d’urgence et soins infirmiers. Le cadre régional pour la prévention des traumatismes chez l’enfant et l’adolescent a été achevé et un module sur la prévention des traumatismes chez l’enfant a été ajouté au matériel de formation régional pour les représentants communautaires et les bénévoles dans le domaine de la santé.
Le Rapport mondial sur le handicap a été lancé au Soudan et, par la suite, une formation multisectorielle a eu lieu sur la mise en œuvre coordonnée de la stratégie nationale contre le handicap. Une formation pour l’établissement de rapports sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées a été organisée en collaboration avec la Ligue des États arabes et d’autres partenaires. En outre, une évaluation rapide des services de réadaptation, qui portait une attention spécifique aux aides techniques, prothèses et orthèses, a été menée en Égypte et en Tunisie.
Promotion de la santé et éducation sanitaire
En matière de promotion de la santé, le Bureau régional a mis au point un instrument visant à faciliter l’élaboration de plans d’action nationaux et l’engagement de multiples secteurs. Dans le cadre des activités de l’OMS ayant trait au Règlement sanitaire international, le Bureau régional, en collaboration avec le Siège de l’OMS et l’Université de l’Indiana, a évalué les capacités existantes dans le domaine de la communication sur les risques en période de crise sanitaire et a élaboré un projet de cadre en la matière. Ce cadre a été élaboré afin d’identifier précisément les différents « nœuds » de communication qui interviennent en situation d’urgence ainsi que les besoins en matière de coordination.
En collaboration avec les Centers for Disease Control and Prevention d’Atlanta et le Siège de l’OMS, l’enquête mondiale sur la santé à l’école a été étendue à l’Iraq, au Qatar et au Soudan.
Dans le domaine de la santé bucco-dentaire, le Bureau régional a organisé une réunion d’experts afin d’apporter la touche finale à la stratégie régionale pour la promotion de la santé bucco-dentaire et à un ensemble d’indicateurs de base en la matière.
Déterminants sociaux de la santé et égalité entre les sexes
L’OMS a fourni un soutien technique à certains pays pour l’élaboration d’un plan d’action et d’un ensemble d’interventions sur les déterminants sociaux de la santé. Un plan stratégique régional pour la mise en œuvre de la Déclaration politique de Rio sur les déterminants sociaux de la santé a été conçu et discuté lors d’un séminaire-atelier interpays.
Le programme Villes-santé s’est développé dans toute la Région, avec la mise en œuvre d’un outil intitulé en anglais Urban Health Equity Assessment and Response Tool permettant d’identifier les lacunes concernant l’équité en matière de santé dans les villes et d’apporter des réponses politiques. Le Bureau régional a épaulé le ministère de la Santé soudanais pour l’élaboration et l’essai sur le terrain d’un manuel de formation à la gestion des risques lors des catastrophes dans les communautés, dont le but est de stimuler l’action communautaire, notamment pour la prévention des risques dus aux catastrophes. Le site Web du réseau régional des villes-santé a été lancé en janvier 2012 afin de permettre aux maires et aux gouverneurs d’inscrire leurs villes et de partager leurs innovations et leurs données d’expérience. |
|

Le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) est un nouveau coronavirus qui a été détecté pour la première fois chez un patient en Arabie saoudite en septembre 2012.
Pour un nombre de patients, notamment ceux qui sont atteints d’une maladie chronique, le virus peut causer de symptômes graves qui requièrent un soin intensif à l’hôpital.
Les symptômes communs sont les suivants : une maladie respiratoire aiguë avec de la fièvre, la toux et une insuffisance et des difficultés respiratoires. La présence d’une pneumonie virale ainsi que des symptômes gastro intestinaux, dont la diarrhée, est fréquente pour la plupart des patients.
Dans la Région de la Méditerranée orientale, certains pays (Égypte, Jordanie, Kuweit, Liban, Oman, Arabie saoudite, Tunisie, Qatar, Émirats arabes unis et Yémen) ont, jusqu’ici, notifiés des cas confirmés au laboratoire du MERS-CoV. La source de l’infection humaine reste inconnue. Cependant, les données scientifiques actuelles suggèrent que le virus est transmis à travers des chameaux, mais la mode de transmission du virus des chameaux à l’homme demeure inconnue quoique les contacts direct et indirect avec les chameaux soient présumés être un facteur de risque pour la transmission du virus à l’homme.
Programme des maladies transmissibles
Derniéres mises à jour
Ressources
Orientations techniques
|
|
|
Promouvoir la santé tout au long de la vie |
 |
 |
Santé maternelle, génésique et infanto-juvénile
La mortalité maternelle et infanto-juvénile demeure un problème de santé publique majeur dans la Région. L’importante charge de mortalité maternelle et infantile qui prévaut dans certains pays est due à plusieurs facteurs principaux, à savoir le manque d’engagement durable en faveur de la santé de la mère et de l’enfant ; les faiblesses des systèmes de santé et les insuffisances dans la gestion des programmes de santé de la mère et de l’enfant ; les catastrophes naturelles et d’origine humaine ainsi que les crises politiques ; et enfin l’utilisation infra-optimale des ressources humaines et financières déjà limitées. Les défis que doivent relever les systèmes de santé, mentionnés dans la précédente partie du présent rapport, ont de graves conséquences sur la prestation de soins de santé aux mères et aux enfants. L’insuffisance des effectifs et leur mauvaise répartition, la formation inadaptée et la forte rotation des personnels de santé à tous les niveaux constituent des obstacles majeurs pour les pays à forte charge de mortalité maternelle et infanto- juvénile. Les autres défis importants concernent le mauvais fonctionnement ou l’insuffisance des systèmes d’orientation-recours, l’insuffisance ou la mauvaise qualité des soins d’urgence pour les mères et les enfants dans les hôpitaux de recours ainsi que la faible disponibilité des médicaments essentiels qui est directement liée à l’accessibilité et à la qualité des services.
Conscients de la nécessité d’intensifier les efforts des gouvernements, des partenaires et des donateurs afin de répondre aux besoins de la Région en matière de santé maternelle et infanto- juvénile, l’OMS, l’UNICEF et l’UNFPA, en collaboration avec les États Membres et d’autres parties prenantes, ont lancé conjointement une initiative régionale, intitulée « Sauver les vies des mères et des enfants », qui vise à accélérer les progrès sur la voie de la réalisation des OMD 4 et 5. Les premières approches stratégiques adoptées dans le cadre de cette initiative consistaient à accorder la priorité aux pays à forte charge de mortalité maternelle et infantile, à se concentrer sur les interventions rentables à fort impact mises en œuvre au niveau des soins de santé primaires et à renforcer les partenariats.
L’initiative est axée sur les pays à forte charge de mortalité, à savoir l’Afghanistan, Djibouti, l’Égypte, l’Iraq, le Maroc, le Pakistan, la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud3 et le Yémen. Elle a été lancée lors d’une réunion de haut niveau à Dubaï (Émirats arabes unis), en janvier 2013, et s’est conclue par la Déclaration de Dubaï qui a suscité une certaine dynamique et fourni aux États Membres une orientation sur l’action à mener.
Les profils de chacun des pays à forte charge ont été établis ; parallèlement, une estimation de l’impact sanitaire probable et des progrès accomplis sur la voie de la réalisation des cibles fixées par les OMD 4 et 5, de l’intensification de la couverture des interventions essentielles ; et une estimation des ressources financières nécessaires pour y parvenir ont été réalisées. L’OMS a fourni un appui technique aux pays concernés, en collaboration avec l’UNICEF et l’UNFPA, pour l’élaboration de plans visant à accélérer les progrès en matière de santé de la mère et de l’enfant. Cet appui a consisté en l’organisation d’une réunion de partenaires, le suivi du processus d’élaboration des plans, et des mesures prises pour le lancement de ces plans dans les pays. Fin 2013, des plans avaient été lancés dans quatre pays.
Entretenant la dynamique engendrée par la réunion de haut niveau, le Comité régional a adopté une résolution (EM/RC60/R.6) approuvant la Déclaration de Dubaï et invitant instamment les pays où la charge de morbidité est élevée à renforcer les partenariats multisectoriels afin de mettre en œuvre leurs plans d’accélération nationaux ; à allouer les ressources humaines et financières nationales requises et à s’employer à mobiliser des ressources supplémentaires auprès des donateurs, des partenaires et des agences de développement. Le Bureau régional a alloué 2,6 millions de dollars US à la mise en route de ces plans, et tous les pays prioritaires pour les OMD 4 et 5 ont reçu des fonds.
Le Bureau régional a suivi de près et a soutenu l’application dans les pays prioritaires des feuilles de route de la Commission de l’Information et de la Redevabilité des Nations Unies pour la santé de la femme et de l’enfant. Sept feuilles de route (pour l’Afghanistan, Djibouti, l’Iraq, le Maroc, le Pakistan, la Somalie et le Yémen) ont été vérifiées avec le Siège de l’OMS et des fonds catalyseurs ont été débloqués en conséquence.
L’OMS fera le suivi des progrès réalisés dans la mise œuvre de l’initiative régionale « Sauver les vies des mères et des enfants », conformément aux recommandations prévues dans le cadre de redevabilité de la Commission de l’Information et de la Redevabilité des Nations Unies pour la santé de la femme et de l’enfant, et en rendra compte chaque année au Comité régional. Les résultats des plans d’accélération seront évalués en collaboration avec les partenaires. Dans l’intervalle, les activités de l’OMS devront être intensifiées afin de fournir le soutien technique adéquat aux pays où la charge est élevée.
Nutrition
L’estimation de la prévalence du retard de croissance et du déficit pondéral chez les enfants de moins de cinq ans a connu une baisse, passant respectivement de 40,4 % et 22,6 % en 1990 à 27,2 % et 14,4 % en 2011. On retrouve les améliorations les plus significatives dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe, en République islamique d’Iran, en Jordanie, au Liban, en Palestine et en Tunisie. L’estimation de la prévalence de l’émaciation a augmenté, passant de 9,6 % en 1991 à 10,1 % en 2011. Cette augmentation est attribuée aux catastrophes, à l’insécurité alimentaire et à l’instabilité politique en Afghanistan, à Djibouti, en Iraq, au Pakistan, en République arabe syrienne, en Somalie et au Yémen.
Les carences en micronutriments (fer, vitamine A et iode) restent un important problème de santé. En effet, selon des études menées en 2012- 2013, quatre pays (Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis et Jordanie) sont exempts de carences en iode et des études en cours de réalisation dans trois autres pays (Koweït, Oman et Qatar) indiqueront vraisemblablement des résultats similaires ; ceci modifiera la cartographie de la carence en iode. La carence clinique en vitamine A est en grande partie maîtrisée grâce aux programmes en cours de supplémentation et d’enrichissement. L’enrichissement obligatoire de la farine en fer et en acide folique dans près de l’ensemble des pays pour faire face au problème de l’anémie constitue toujours un défi ; cependant, les impacts positifs de cette mesure ont été signalés à Bahreïn et en Jordanie.
Plusieurs interventions nutritionnelles ciblées s’inscrivent dans le cadre des plans d’accélération en vue de réaliser les OMD 4 et 5 dans les pays à forte charge de mortalité. Il s’agit notamment de la supplémentation en acide folique et en fer et de l’établissement de centres de stabilisation nutritionnelle pour le traitement des cas graves et complexes de malnutrition en Afghanistan, au Pakistan et au Yémen. En Iraq, près de 90 % des cas de malnutrition sévère et aiguë sont couverts dans tout le pays. L’intensification des interventions nutritionnelles, notamment le renforcement des capacités et la formation des agents communautaires et des agents de santé, en coordination avec l’UNICEF, le PAM et la FAO fonctionne bien. L’OMS a fourni un soutien technique au Pakistan et au Yémen, dans le cadre de l’initiative Scaling Up Nutrition (SUN) [Initiative pour le renforcement de la nutrition] qui mobilise des ressources supplémentaires auprès du gouvernement et des donateurs, tandis que le Pakistan bénéficie du soutien de l’initiative REACH (Renforcement des efforts de lutte contre la faim des enfants).
Les faibles taux d’allaitement au sein exclusive (moins de 34 %) ainsi que les mauvaises pratiques d’alimentation des nourrissons et des enfants contribuent à l’augmentation de la prévalence du surpoids et de l’obésité. Certains pays comme Bahreïn intègrent le suivi de la nutrition et de la croissance aux services dispensés dans les cliniques de soins primaires afin de s’attaquer très tôt à l’obésité. Des hôpitaux « amis des bébés » ont été créés dans plusieurs pays afin d’encourager l’allaitement. Néanmoins, 33 ans après l’adoption du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel en 1981, on constate que sur 22 pays, seuls sept (32 %) ont adopté des lois qui tiennent compte de l’ensemble des dispositions du Code, tandis que 11 pays ont adopté des lois ne prenant en compte que quelques dispositions du Code. Une déclaration de principe et un plan d’action régionaux ont été élaborés afin d’encourager l’application intégrale du Code et de promouvoir l’allaitement au sein dans l’ensemble des pays. Le suivi dans ce domaine devra se poursuivre dans les années à venir.
Vieillissement et santé des groupes particuliers
Les interventions visant la prévention et la promotion de la santé qui ont lieu très tôt dans la vie constituent des investissements qui ont un bon rapport coût-efficacité pour la santé des écoliers, des adultes actifs et des personnes âgées. L’appui fourni aux écoles qui prennent des mesures visant à promouvoir la santé s’est poursuivi à travers l’élaboration de profils de pays et la création de bases de données dans sept pays. Un guide régional comprenant des mesures proposées pour les services de santé scolaires a été finalisé, et des méthodologies en vue de l’institutionnalisation de la promotion de la santé mentale dans les écoles ont été préparées.
Dans le cadre des efforts régionaux pour la mise en œuvre du plan d’action mondial pour la santé des travailleurs, un soutien technique a été fourni à plusieurs pays. Cependant, une nouvelle vision et une stratégie complète sur la médecine du travail sont nécessaires et en 2014, les activités seront axées sur ces aspects. Les personnes âgées devenant plus nombreuses et davantage visibles dans la Région par rapport à la population générale, il est impératif de mettre en œuvre de meilleures stratégies afin de répondre à leurs besoins particuliers en matière de services sociaux et de santé. Un soutien technique a été apporté aux pays pour l’instauration d’environnements favorables, de cadres de promotion de la santé et de modes de vie sains pour tous les groupes d’âge. Un projet de guide de formation régional sur les services de soins de santé primaires pour les personnes âgées a été examiné lors d’une consultation régionale sur les services de soins de santé amis des aînés.
Violence, traumatismes et incapacités
En 2013, la mise en œuvre du plan quinquennal régional de prévention des traumatismes a débuté, mettant l’accent sur les traumatismes dus aux accidents de la circulation et les soins traumatologiques. La publication du Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde 2013, couvrant la plupart des pays de la Région, a jeté les bases de la surveillance de la Décennie d’action pour la sécurité routière 2011-2020. La deuxième semaine mondiale de la sécurité routière des Nations Unies, consacrée à la sécurité des piétons, a été célébrée dans plusieurs pays, et un instrument pilote pour établir le profil des systèmes de soins traumatologiques a également été conçu. L’enquête pour le rapport sur la prévention de la violence mondiale s’est achevée dans 88 % des pays participants. En 2014-2015, l’accent sera davantage mis sur l’appui fourni aux ministères de la Santé pour leur permettre de remplir le rôle qui leur incombe, dans le cadre d’une action multisectorielle de plus grande ampleur dans les domaines de la prévention de la violence et des traumatismes ainsi que le handicap et la rehabilitation.
Sur la base de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, un projet de loi type sur le handicap a été élaboré. Une déclaration régionale conjointe des Nations Unies sur le handicap et les catastrophes a indiqué l’engagement à intensifier les efforts pour l’inclusion des personnes handicapées dans l’ensemble des politiques et programmes visant à réduire les risques de catastrophe et à faire face aux situations humanitaires. Les États Membres ont contribué à la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le handicap et le développement et à l’élaboration du plan d’cation mondial de l’OMS sur le handicap.
De nombreux pays sont confrontés à des obstacles Asieen ce qui concerne les déficiences visuelles et auditives, les plus importants obstacles étant notamment le manque d’appui politique adéquat et l’insuffisance des ressources financières. Cependant, suite à l’approbation par l’Assemblée mondiale de la Santé du Plan d’action mondial pour la prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables 2014-2019, quatre pays ont élaboré des plans nationaux de santé oculaire sur cinq ans. Un nouveau membre du personnel professionnel ayant de l’expérience dans la prévention de la cécité a récemment été recruté, en collaboration avec l’Initiative internationale contre les incapacités évitables pour la Région de la Méditerranée orientale (IMPACT-EMR), en vue de renforcer le soutien technique fourni aux pays à forte charge.
Éducation sanitaire et promotion de la santé
En 2013, l’amélioration de la santé de la population tout au long de la vie a constitué l’axe principal de l’éducation sanitaire et de la promotion de la santé, en particulier la santé des enfants, des femmes et des adolescents ainsi que les maladies non transmissibles. Une consultation avec des universitaires religieux consacrée aux pratiques préjudiciables à la femme a abouti à un accord avec le Centre islamique international pour les études et la recherche en matière de population de l’Université Al Azhar (Égypte) et à l’élaboration d’un plan de travail conjoint qui devra être mis en œuvre dans les pays prioritaires de la Région. Cela conduira en 2014 à un examen documentaire des expériences aux niveaux régional et international en ce qui concerne la lutte contre le mariage d’enfants et la violence à l’encontre des femmes, y compris les mutilations sexuelles féminines, et à l’élaboration de dispositifs de formation ainsi que d’un programme d’enseignement pour les étudiants de l’Université Al Azhar.
En collaboration avec les Centers for Disease Control and Prevention d’Atlanta (États-Unis d’Amérique), l’OMS a étendu à plusieurs nouveaux pays la réalisation de l’enquête mondiale sur la santé des élèves en milieu scolaire et a mené de nouvelles enquêtes dans d’autres pays. Les enquêtes fournissent aux pays des données comparatives sur les facteurs de risque comportementaux chez les écoliers qui peuvent éclairer l’élaboration de politiques et de programmes de promotion de la santé destinés aux milieux scolaires. Un programme régional visant à encourager la promotion de la santé dans les médias a été lancé et celui-ci permettra de renforcer les capacités des journalistes en matière de couverture des questions de santé et de mise en réseau de l’information. Le programme est en cours de mise en œuvre, en collaboration avec la Fondation Thomson Reuters et l’Agence France- Presse.
Déterminants sociaux de la santé et différenciation homme-femme
La pauvreté et la répartition inégale des ressources entre les populations urbaines et rurales représentent les principaux déterminants sociaux de la santé dans la Région. Les groupes vulnérables tels que les pauvres, les mères de famille monoparentale et les réfugiés sont plus exposés aux inégalités en santé que les autres groupes de population.
Des initiatives visant à aborder la question des déterminants sociaux et de la différenciation homme-femme dans le secteur de la santé continuent d’être fondées sur une approche verticale plutôt que d’être intégrées à des approches programmatiques. Les défis sont notamment le manque de données ventilées par sexe sur l’équité, la nécessité de maintenir les activités intersectorielles et enfin l’incapacité à intégrer les déterminants sociaux de la santé et la parité homme-femme dans les programmes, politiques et stratégies de santé. L’OMS a collaboré avec les États Membres dans le cadre de plusieurs initiatives s’intéressant aux déterminants sociaux de la santé mais jusqu’à présent il n’existe pas de vision complète et concrète en vue de l’élaboration d’un plan pragmatique régional. Un nombre considérable de pays a décidé d’accorder la priorité à ce domaine d’action dans le cadre de leur programme respectif de collaboration avec l’OMS en 2014 et au-delà, et des activités ont débuté pour mettre au point le plan d’action. Nous espérons rendre compte favorablement de l’issue de ces activités dans le prochain rapport annuel.
Santé et environnement
Malgré la diversité de la Région en termes de revenu, de développement, de santé et de conditions environnementales, trois groupes de pays se distinguent clairement. Le groupe 1 est composé de pays à revenu élevé dont les services de salubrité de l’environnement sont efficaces et qui subissent l’impact direct des risques environnementaux sur les maladies non transmissibles. Le groupe 2 comprend des pays à revenu intermédiaire disposant de systèmes de salubrité de l’environnement en développement, et connaissant une double charge des risques environnementaux sur les maladies transmissibles et non transmissibles. Enfin le groupe 3 comprend les pays à revenu faible ne disposant pas de services de salubrité de l’environnement de base appropriés, et dans lesquels les risques environnementaux ont un véritable impact, surtout sur les maladies transmissibles.
Le Comité régional a approuvé la stratégie pour la santé et l’environnement 2014-2019 qui fournit, pour les trois groupes, une feuille de route visant à protéger la santé face aux risques environnementaux dans la Région. Cette feuille de route définit les mesures nécessaires à prendre en vue de réduire la lourde charge du risque environnemental, qui selon les estimations représente près de 24 % de la charge de morbidité totale, y compris plus d’un million de décès par an au niveau régional. Le défi consiste désormais pour les pays à traduire cette stratégie en plans d’action nationaux et pour l’OMS, à suivre les progrès.
Dans le cadre d’une réforme organisationnelle et structurelle, le Centre régional de l’OMS pour les activités d’hygiène de l’environnement (CEHA) est chargé depuis 2013 de la gestion globale du programme régional pour l’environnement ; l’objectif étant de renforcer les capacités de l’OMS en matière de fourniture de soutien technique aux États Membres. Des activités ont été organisées dans les domaines suivants : qualité de l’eau de boisson ; réutilisation des eaux usées et gestion de la sécurité sanitaire de l’eau ; dangers chimiques constituant une situation d’urgence ; qualité de l’air ; changement climatique ; gestion des déchets d’activités de soins ; stratégies pour la salubrité de l’environnement et gestion de l’information relative à la salubrité de l’environnement. Un appui technique pour la salubrité de l’environnement a été fourni dans plusieurs situations d’urgence, la crise syrienne en particulier, et les capacités en matière de préparation et de riposte aux incidents chimiques dans la Région ont été renforcées. Un appui a également été fourni afin de permettre aux pays de satisfaire aux exigences principales en vue de l’application du Règlement sanitaire international (2005) en ce qui concerne la sécurité sanitaire des aliments et les évènements chimiques et radionucléaires.
En réponse aux demandes de plusieurs États Membres, le Centre CEHA a mené une étude novatrice en Jordanie afin de produire des données scientifiques sur les exigences sanitaires minimales en matière d’eau dans les foyers pour la protection de la santé. L’étude conduite auprès de 2851 foyers a examiné la corrélation entre la consommation d’eau dans les foyers et l’incidence de la diarrhée chez les enfants âgés de moins de cinq ans. Les résultats fournissent des données qui permettront d’orienter l’élaboration de politiques et/ou d’instruments législatifs nationaux pour les objectifs de service et les subventions en vue de garantir un approvisionnement en eau dans les foyers satisfaisant aux exigences sanitaires minimales pour la protection de la santé. L’étude devrait être menée dans différents lieux afin de produire davantage de données et permettre ainsi à l’OMS d’élaborer des recommandations.
3 Depuis mai 2013, le Soudan du Sud est un État Membre de la Région OMS de l’Afrique |
|
Promouvoir la santé tout au long de la vie |
 |
 |
L’approche fondée sur les étapes de la vie
La santé est une résultante des politiques menées dans tous les domaines, notamment celles ayant trait aux déterminants sociaux de la santé. En 2014, l'OMS a poursuivi son action pour fournir un appui aux pays afin de protéger et promouvoir la santé, la sécurité et le bien-être de la population de la Région, tout au long de l'existence. À cet égard, une attention particulière a été accordée à la santé de la mère et de l’enfant en tant que priorité stratégique.
Santé maternelle, génésique et infanto-juvénile
Entre 1990 et 2013, le taux de mortalité maternelle a chuté de 50 % et le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans de 46 % dans la Région (voir Figures 1 et 2). Le taux de mortalité maternelle est passé du deuxième au troisième taux le plus élevé parmi les régions de l'OMS, après les régions de l'Afrique et de l’Asie du Sud-Est. En dépit de ces réalisations, ces taux de réduction se situent nettement en deçà des cibles des objectifs du Millénaire pour le développement 4 (réduction de 67 % du taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans) et 5 (diminution de 75 % du ratio de mortalité maternelle) d’ici à 2015. De plus, 26 000 mères et 845 000 enfants de moins de cinq ans meurent toujours chaque année dans la Région. Près de 95 % de ces décès surviennent dans neuf États Membres qui ont une charge élevée de mortalité maternelle et infantile.
Plusieurs facteurs contribuent au niveau élevé de mortalité maternelle et infantile. La faiblesse des systèmes de santé, avec le manque de ressources humaines bien formées et en effectifs suffisants, l’incapacité à maintenir la disponibilité des produits nécessaires, et le mauvais fonctionnement des systèmes d’orientation-recours, représentent un défi majeur dans les pays fortement touchés. Cette situation est aggravée par l'instabilité politique, les troubles sociaux, et les crises aiguës et chroniques prolongées qui affectent ces pays.
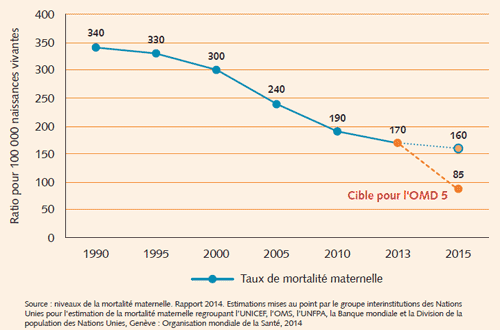
Figure 1 - Tendance de la mortalité maternelle pour la période 1990-2013 et extrapolation pour 2015
Source : niveaux de la mortalité maternelle. Rapport 2014. Estimations mises au point par le groupe interinstitutions des Nations Unies pour l'estimation de la mortalité maternelle regroupant l’UNICEF, l’OMS, l’UNFPA, la Banque mondiale et la Division de la population des Nations Unies, Genève : Organisation mondiale de la Santé, 2014
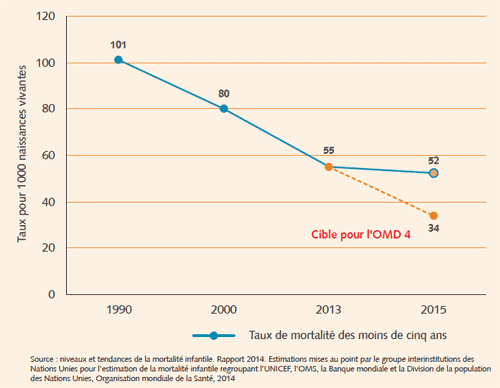
Figure 2 - Tendance de la mortalité des moins de cinq ans pour la période 1990-2013 et extrapolation pour 2015
Source : niveaux et tendances de la mortalité infantile. Rapport 2014. Estimations mises au point par le groupe interinstitutions des Nations Unies pour l'estimation de la mortalité infantile regroupant l’UNICEF, l’OMS, la Banque mondiale et la Division de la population des Nations Unies, Organisation mondiale de la Santé, 2014
En 2014, le Bureau régional a maintenu son appui à la santé génésique, maternelle, néonatale, infantile et de l'adolescent, l'accent étant mis en particulier sur la santé de la mère et de l'enfant dans les neuf pays prioritaires, en collaboration étroite avec l'UNFPA et l'UNICEF. Les fonds que l’OMS a alloués en 2013 pour lancer la mise en œuvre des plans d’accélération nationaux avaient été absorbés fin septembre 2014. Ces fonds ont été utilisés pour faciliter la mise en œuvre des activités prioritaires, notamment le renforcement des capacités des prestataires de santé ; l’achat de produits d'importance vitale et le renforcement des interventions à base communautaire. Les neuf pays ont tous identifié la santé de la mère et de l’enfant comme programme prioritaire pour l'exercice 2014-2015 et par conséquent, 7 millions de dollars US supplémentaires ont été fournis pour les activités de mise en œuvre, par le biais du programme de collaboration de l'OMS. En outre, deux montants de sept et dix millions de dollars ont été mis à disposition à partir des ressources des fonds fiduciaires en vue de soutenir des activités prioritaires pertinentes en Afghanistan et au Pakistan respectivement.
La situation actuelle et les défis auxquels font face les pays dans les domaines de la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, y compris les principales causes de la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans la Région, ont été examinés au cours d’une réunion interpays destinée aux administrateurs des programmes nationaux, qui a été organisée conjointement avec l’UNFPA et l’UNICEF en juin 2015. Suite à cette réunion, des actions prioritaires visant à faciliter la mise en œuvre des plans d’accélération en 2015, ainsi que des orientations stratégiques pour les programmes de santé génésique, maternelle, néonatale et infantile pour l’après-2015 ont été identifiées. L’OMS a maintenu un suivi étroit, a continué de fournir un soutien pour la mise en œuvre des plans et a apporté une assistance technique afin de combler les lacunes identifiées lors des missions réalisées dans les pays. Une attention particulière est accordée au renforcement des éléments associés aux systèmes de santé. Il s'agissait notamment de l'analyse de la disponibilité des ressources humaines pour les services de santé de la mère et de l'enfant, de l'évaluation des services en termes de qualité et de lutte contre les infections, et de la promotion des activités de recherche opérationnelle afin de combler les lacunes du système de prestation de soins de santé.
L’appui fourni aux pays dans la mise en place et le renforcement des soins préconceptionnels constitue une autre priorité pour les activités de l’OMS dans la Région. L’objectif est d’améliorer davantage les résultats en matière de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant dans les États Membres. Une réunion organisée avec les États Membres et des experts régionaux et internationaux a permis de parvenir à un consensus sur un ensemble d'interventions de base et des modes de prestation de services pour les soins préconceptionnels. Des activités supplémentaires sont planifiées pour 2015 afin d’examiner plus en détail les bases factuelles concernant ces interventions et d’élaborer un cadre opérationnel régional.
L'OMS, en collaboration avec des partenaires, a entrepris une analyse des réalisations dans les pays eu égard aux OMD 4 et 5. L'analyse indique que sept pays ont atteint de faibles taux de mortalité maternelle et infantile, et que six de ces pays ont réalisé l'OMD 4 et deux pays l'OMD 5. Compte tenu de ce qui précède, cinq pays, en plus des neuf pays prioritaires, devraient faire l'objet d’une attention plus importante pour les activités relatives à la santé de la mère et de l'enfant, et ce jusqu'à la fin 2015. Les crises qui se déroulent dans plusieurs pays ont eu de graves conséquences sur les réalisations antérieures. Il est nécessaire d'adopter des approches novatrices afin de répondre aux besoins sanitaires des mères et des enfants dans cette situation. Même dans les pays qui ont de faibles taux de mortalité maternelle et infantile, des plans stratégiques sont requis pour soutenir les réalisations existantes et mettre en œuvre des interventions ciblées afin de réduire davantage ces taux de mortalité, et plus particulièrement la mortalité néonatale.
Il ne reste désormais que quelques mois pour rendre compte de la situation concernant la réalisation des OMD. Sur les neufs pays prioritaires, plusieurs auront encore des taux de mortalité élevés mais auront démontré des progrès significatifs, grâce aux efforts conjoints et intensifiés. Il sera crucial de poursuivre ces efforts et d'élaborer des plans appropriés, sur la base du programme de développement pour l’après 2015. L'engagement et la participation des États Membres seront indispensables pour dynamiser le débat sur le programme pour l’après-2015 et pour s'attaquer aux priorités relatives à l'Initiative Sauver les vies des mères et des enfants. La stratégie mondiale actualisée pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent, qui sera lancée à l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2015, s’appuie sur la stratégie 2010-2015, en tirant les enseignements des objectifs du Millénaire pour le développement et en mettant l’accent sur l’action et l’investissement efficaces. Elle aura pour cible la réalisation de l’équité, des droits de l’homme et des déterminants sociaux de la santé. Les États Membres devront aligner leurs orientations stratégiques sur cette stratégie et la mise en œuvre quinquennale du plan qui sera proposé pour adoption formelle à l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 2016.
Nutrition
Dans la Région, les indicateurs relatifs à la nutrition continuent d'être alarmants. En effet, les pays luttent contre des taux élevés de malnutrition, les mauvaises pratiques en matière d'alimentation, les carences en micronutriments et l'obésité. La malnutrition contribue considérablement à la mortalité de l’enfant. Elle est la principale cause sous-jacente des décès des enfants de moins de cinq ans, étant ainsi à l’origine de 45 % des décès d’enfants dans le monde, ainsi que dans la Région, en 2013. L’anémie, qui nuit à la santé et au bien-être des femmes et augmente les conséquences négatives pour la santé de la mère et du nouveau-né, touche près de 40 % des femmes en âge de procréer dans la Région. L’OMS collabore avec les États Membres en vue de la mise en œuvre complète du plan concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant et de ses cibles mondiales qui ont été adoptées par l’Assemblée mondiale de la Santé en 2012.
En ce qui concerne la dénutrition chez l’enfant de moins de cinq ans, la moyenne régionale pondérée pour le retard de croissance est de 28 % ; elle est de 8,71 % pour l’émaciation et de 18 % pour le déficit pondéral. Les pays de la Région ayant la charge la plus élevée de retard de croissance et de déficit pondéral sont l’Afghanistan, Djibouti, le Pakistan, le Soudan et le Yémen, où la prévalence du retard de croissance est comprise entre 33,5 % et 46,5 % et celle du déficit pondéral entre 25 % et 39 %. Le taux de modification annuel pour la prévalence du retard de croissance indique que plusieurs pays (Égypte, Liban, Maroc, Palestine) sont en voie d’atteindre la cible fixée pour 2025 concernant ce problème de santé.
Malgré les engagements mondiaux en faveur de la promotion de l’allaitement au sein exclusif, le niveau de pratique dans la Région reste toujours faible, soit 34 %. Le taux d'application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel dans la Région demeure en-deçà de la cible mondiale (50 %). Une évaluation régionale menée en 2014 a montré que seuls cinq pays appliquent intégralement ce Code ; 10 pays l'appliquent partiellement et six ne l'appliquent pas du tout. Une consultation régionale a été organisée afin de discuter des moyens d'accélérer l'application du Code. Ces discussions se sont conclues par une déclaration de politique régionale et un plan d’action sur le besoin urgent de mise en œuvre complète du Code et des résolutions y afférentes de l’Assemblée mondiale de la Santé, qui ont été diffusés à l’ensemble des ministères de la Santé en vue de leur application. L’OMS collabore avec les pays afin de surveiller la mise en œuvre du plan.
Au niveau régional, le surpoids et l'obésité chez les enfants de moins de cinq ans ont augmenté, passant de 5,8 % à 8,1 % entre 1990 et 2012, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale de 6,7 %. La prévalence du surpoids et de l'obésité chez les adolescents (13-15 ans) est très forte, en particulier dans les pays du groupe 1 et certains pays du groupe 2. La plupart des pays de ces groupes ont des taux de surpoids et d'obésité supérieurs à la valeur médiane mondiale de 21,7 %. Des données ne sont actuellement disponibles dans la Région que pour deux groupes d'âge, à savoir les moins de cinq ans et les 13-15 ans.
Les défis auxquels font face les programmes de nutrition dans la Région, notamment dans les pays appartenant au groupe 3, sont énormes. La nécessité d’augmenter l’engagement et la priorité accordée à la nutrition dans l’ensemble des pays est urgente. Une réunion interpays sur la nutrition a été organisée en juin 2015 en vue de guider les États Membres pour la mise en œuvre des recommandations de la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2). Un ensemble de sept initiatives prioritaires ont été identifiées au cours de la réunion. Un cadre régional sera préparé en 2015 afin de traduire ces priorités en actions concrètes pour leur mise en œuvre durant la prochaine période biennale et au-delà.
Vieillissement et santé des groupes spéciaux
Malgré les priorités concurrentes, plusieurs pays ont pris des mesures pour renforcer les efforts dans les domaines du vieillissement actif et en bonne santé et de la santé des groupes spéciaux. Les pays accordent actuellement une attention particulière au renforcement des programmes concernant le vieillissement actif et en bonne santé et à la mise en œuvre du plan d’action mondial pour la santé des travailleurs. L’initiative sur les soins de santé primaires accessibles à la population âgée a été mise en œuvre dans certains pays et les résultats sont utilisés en vue d’améliorer la performance du programme.
Le Bureau régional a fourni un appui technique aux pays du Conseil de Coopération du Golfe afin de les aider à mettre au point des mécanismes leur permettant d'appliquer les normes en matière de santé au travail et de salubrité de l’environnement pour l'accréditation des hôpitaux et d’autres établissements de soins de santé, avec des rôles clairement identifiés pour les parties prenantes concernées. Un plan d'action détaillé comprenant des indicateurs de processus et un calendrier a été élaboré pour développer les services concernant la santé des travailleurs dans ces pays. La collaboration avec le programme de santé mentale s'est poursuivie avec pour objectif de renforcer les services psychosociaux dans le contexte de la santé scolaire et d'institutionnaliser la promotion de la santé mentale et les services dans ce domaine. La situation d’urgence complexe qui prévaut dans 16 pays de la Région met en évidence le besoin d’intégrer une composante de santé mentale dans les programmes de santé scolaire. Un module de formation destiné aux enseignants a été finalisé et a fait l'objet d'un examen par des pairs et par des examinateurs extérieurs lors d'une Consultation régionale qui s'est tenue au Caire ; il sera testé dans cinq pays. Compte tenu de l’importance des écoles en tant que point d’accès à plusieurs interventions de santé publique, le besoin d’élaborer des critères intégrés pour des écoles-santé est en augmentation. L’action dans cette direction est continue et une nouvelle initiative sera lancée au cours de la seconde moitié de 2015.
Violence, traumatismes et handicaps
La Région vient en deuxième place parmi les régions de l’OMS pour le taux de mortalité imputable aux accidents de la circulation (21,3 pour 100 000 personnes par rapport au taux mondial de 18,3 pour 100 000 personnes). Bien que la majorité des décès surviennent dans les pays à revenu intermédiaire, les pays à revenu élevé ont le taux de mortalité le plus élevé parmi les pays similaires dans le monde. Les accidents de la circulation représentent évidemment une sérieuse préoccupation pour tous les pays de la Région indépendamment de leur niveau de revenu. De graves lacunes sont persistantes dans la mise en œuvre exhaustive d’interventions d’un bon rapport coût-efficacité et ayant fait leur preuve. Bien que la majorité des pays aient appliqué certains des aspects de ces interventions, ces dernières n’ont pas été mises en œuvre en tant qu’ensemble englobant tous les éléments essentiels, ce qui a un impact sérieux sur l’efficacité de ces interventions.
L’inadaptation de l’engagement politique, l’insuffisance de la coordination et de l’action multisectorielle, la faiblesse de l’application, de la mise en œuvre et de l’évaluation des cadres législatifs et politiques, la sous-notification et la fragmentation de multiples systèmes de données ainsi que les graves lacunes dans les soins post-traumatiques et les services de réadaptation font partie des défis dans ce domaine. Le secteur de la santé a encore besoin d’assumer pleinement son rôle en vue de lutter contre les traumatismes et de les prévenir.
Une réunion régionale de planification pour la prévention des accidents destinée aux points focaux du ministère de la Santé a été organisée. Au cours de cette réunion, les pays ont identifié les activités prioritaires en vue de les intégrer au sein de leurs plans nationaux. Un cadre régional pour la sécurité routière a été élaboré en consultation avec les pays et des experts externes. Les pays ont achevé l'exercice de notification pour le rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde 2015 qui suivra les progrès accomplis durant la Décennie d’action pour la sécurité routière 2011-2020. Une méthodologie normalisée pour l'estimation du coût des traumatismes dus aux accidents de la route a été mise au point et fera l’objet d’essais en 2015. Un instrument régional permettant d’établir le profil des systèmes de soins traumatologiques a été testé dans trois pays, préparant ainsi le terrain pour un élargissement à d'autres pays.
Une réunion de haut niveau sur la sécurité routière est prévue pour le début de l’année 2016 afin d'augmenter l’engagement politique et de convenir d’actions concrètes pour des progrès accélérés durant la deuxième moitié de la décennie d’action. En préparation de cette réunion, une consultation d’experts sera organisée pour finaliser le cadre d’action spécifique afin d’examiner le document de référence pour la réunion qui est en préparation par l’OMS avec la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Ce document présentera la plupart des informations sur la charge des traumatismes dus aux accidents de la circulation dans la Région ainsi que les recommandations pragmatiques pour les trois groupes de pays, s’appuyant sur des travaux connexes de l’OMS, y compris le rapport de situation mondial 2015, et prenant en compte les développements survenus récemment au niveau mondial tels que les nouveaux objectifs de développement durable.
Dans la domaine de la prévention de la violence, le Rapport de situation mondial sur la prévention de la violence 2014 comprend pour la première fois des informations sur différents aspects du problème de la violence dans seize pays de la Région, soit 63 % de la population. Le rapport montre que les pays à revenu faible et intermédiaire de la Région occupent la troisième place (7 pour 100 000 personnes) pour les taux d’homicide, parmi les pays similaires dans l’ensemble des régions de l’OMS. Plusieurs stratégies de prévention ayant fait l’objet d’un examen se sont avérées être disponibles. Cependant, la mise en œuvre de ces stratégies doit être évaluée. En 2015, des dialogues de politiques au niveau national seront menés dans trois pays sur les résultats du rapport mondial, en vue d’élaborer des plans d’action bien précis afin de combler les lacunes identifiées.
Le projet de plan d’action mondial visant à renforcer le rôle des systèmes de santé dans la lutte contre les violences interpersonnelles, notamment à l’encontre des femmes et des jeunes filles ainsi que des enfants, a été examiné lors d’une consultation régionale. En préparation de la mise en œuvre, une analyse des parties prenantes, ainsi qu’une évaluation de la situation actuelle et des efforts en vue de faire face aux violences à l’encontre des femmes et des jeunes filles et des enfants seront menées.
Depuis le lancement de l’initiative mondiale de l’OMS Vision 2020 : le droit à la vue, des progrès ont été réalisés dans certains pays en matière de développement et de renforcement des services de soins oculaires, y compris l’augmentation de la prise en conscience à ce sujet et de l’utilisation effective de ces services, l’intégration des soins de santé primaires et d’indicateurs pertinents au sein des systèmes d’information sanitaire. Cependant, il n’y avait pas de preuves systématiques de l’impact des actions menées par les pays sur la prévalence de la cécité évitable. Plus de la moitié des pays (Arabie saoudite, Afghanistan, Bahreïn, Égypte, République islamique d’Iran, Iraq, Jordanie, Libye, Maroc, Oman, Pakistan, Qatar, Soudan) ont élaboré ou préparent des plans de santé oculaire conformément au plan d’action mondial de l’OMS vers la santé oculaire universelle, suivant le renforcement des capacités régionales mené en collaboration avec la branche de l’Organisation mondiale de lutte contre la cécité dans pour la Méditerranée orientale. En général, le secteur public dans les États Membres n’investit pas suffisamment en vue de lutter contre la cécité et les déficiences visuelles et de prévenir ces affections.
La réalisation de l’objectif d’élimination de la cécité évitable d’ici 2020 dépend de la capacité des systèmes de santé à renforcer leurs efforts. Ceci nécessite l’élaboration et l’intégration des soins de santé oculaire au sein du système de santé général conformément au plan d’action mondial 2014-2019 concernant la santé oculaire universelle.
Éducation sanitaire et promotion de la santé
La Région a la prévalence la plus élevée au monde pour la sédentarité chez les adultes. Selon les recommandations de l’Assemblée mondiale de la Santé et du Comité régional, un forum régional multisectoriel de haut niveau sur une approche de promotion de l’activité physique à toutes les étapes de la vie a été organisé à Dubaï (Émirats arabes unis). Ce forum s’est conclu par un appel régional à l’action en matière d’activité physique, avec un ensemble d’interventions destinées à des secteurs spécifiques. Un Comité consultatif régional a été établi en vue de soutenir la mise en œuvre de cette action.
Une enquête sur l’évaluation des capacités nationales en matière de développement et de mise en œuvre des politiques et des programmes concernant l’activité physique a été étendue de 12 à 16 pays. En 2015, l’OMS a accordé son attention au renforcement des capacités nationales en vue d’élaborer des plans d’action régionaux multisectoriels pour l’activité physique et des plans de marketing social ainsi que des campagnes d’information de masse. En outre, en partenariat avec le Centre collaborateur de l’OMS pour l’activité physique, la nutrition et l’obésité de Sydney (Australie), un module de formation a été mis au point sur l’information de masse et le marketing social en matière d’activité physique et d’alimentation saine, en vue de soutenir les pays dans la mise en œuvre des options les plus rentables dans ce domaine.
Déterminants sociaux de la santé et égalité entre les sexes
Au cours de la période biennale actuelle (2014-2015), 14 pays ont les déterminants sociaux de la santé dans leurs plans de travail, mettant principalement l’accent sur la mise en œuvre de la déclaration politique de Rio sur les déterminants sociaux de la santé ; sur une intégration efficace des déterminants sociaux de la santé dans les programmes de santé ; sur le renforcement des capacités des pays en matière de prise en compte de la santé dans toutes les politiques, l’action intersectorielle et l’engagement social en vue de s’attaquer aux déterminants sociaux de la santé.
Une analyse préliminaire a été préparée par l’OMS et The Institute of Health Equity [Institut d’équité sanitaire] liant les déterminants sociaux et environnementaux de la santé aux inégalités en matière de santé. L’examen de l’analyse a révélé de graves inégalités dans les pays. Les défis identifiés comprenaient un engagement politique insuffisant, des données inadéquates sur l’inégalité et une faible collaboration intersectorielle.
Au cours d’une réunion technique sur les déterminants sociaux de la santé et les inégalités en matière de santé qui s’est tenue juste avant la soixante et unième session du Comité régional, les États Membres ont conclu que les cinq priorités essentielles concernant la santé dans la Région ne pouvaient pas être traitées efficacement sans s’attaquer aux déterminants sociaux de la santé. Ils ont demandé à l’OMS de fournir des orientations stratégiques précises en vue de renforcer l’action intersectorielle et les politiques pangouvernementales et de faire face aux inégalités en matière de santé. Suite à une consultation régionale tenue en République islamique d’Iran au début de l’année 2015, quatre pays participent actuellement à un projet pilote en vue de mener une analyse approfondie des déterminants sociaux de la santé en tant que point de départ.
Santé et environnement
En 2013, le Comité régional a approuvé une stratégie régionale pour la santé et l’environnement et un cadre d’action dans ce domaine pour la période 2014–2019. Seuls neuf pays ont indiqué que la salubrité de l’environnement constituait une priorité pour 2014-2015 ; néanmoins la plupart des pays ont mené des activités ayant trait à la protection de la santé publique contre les risques environnementaux. L’approche d’évaluation et de gestion basée sur le risque présentée dans les lignes directrices sur la qualité de l’eau de boisson et la réutilisation des eaux usées de l’OMS a été encouragée et adaptée pour servir les besoins régionaux et nationaux spécifiques. Jusqu'à présent, 15 pays ont mis à jour leurs normes nationales pour la qualité de l’eau de boisson, conformément aux lignes directrices, et un projet pilote sur l’utilisation des eaux usées pour l’agriculture a été lancé en Jordanie. Huit pays ont adopté des plans de prévention de la sécurité sanitaire de l’eau et 11 pays ont renforcé leur secteur national de surveillance de l'eau et de l'assainissement, dans le cadre de l'Analyse et de l’évaluation mondiales de l’ONU-Eau sur l’assainissement et l’eau potable (GLAAS). Tous les pays ont participé au Programme commun OMS/UNICEF de suivi de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, dont l’issue a montré que la grande majorité des pays ont atteint ou sont en bonne voie pour atteindre les cibles de l’OMD 7 concernant l’eau et l’assainissement.
La réponse de santé publique au changement climatique et à la pollution atmosphérique a fait l'objet de discussions lors des réunions techniques qui ont précédé la soixante et unième session du Comité régional ainsi que lors d'une consultation régionale d'experts. Les États Membres sont engagés à lutter contre les risques pour la santé liés à l’environnement dans le contexte du système de santé publique, en partenariat avec d'autres parties prenantes. Plusieurs pays de la Région ont contribué avec enthousiasme et efficacité à la Conférence de l’OMS sur la santé et le climat qui s'est tenue à Genève. Les pays du Conseil de coopération du Golfe ont élaboré et adopté des normes sanitaires liées à l'environnement et au travail pour l'accréditation des établissements de soins de santé.
Des lignes directrices pour la législation relative à la sécurité sanitaire des aliments ont été élaborées et on a encouragé le recours au Codex Alimentarius dans la Région en 2014. Plusieurs pays ont renforcé leurs capacités dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, et notamment de l'échantillonnage, de l'inspection et du contrôle. Une initiative régionale d’évaluation de la sécurité sanitaire des aliments a été lancée, visant à établir un profil dans ce domaine pour au maximum 16 pays d’ici la fin du mois de septembre 2015. Le but est d’évaluer les forces et les faiblesses des systèmes nationaux de sécurité sanitaire des aliments et d’identifier les actions prioritaires requises pour combler les lacunes identifiées. Cette initiative « De la ferme au consommateur » permettra d’augmenter les capacités des pays pour prévenir, détecter et gérer les risques et les flambées épidémiques associés aux maladies transmises par des aliments.
Afin de soutenir la préparation et la riposte aux situations d'urgence dans la Région, des stocks renouvelables régionaux de fournitures utilisées dans le domaine de la salubrité de l’environnement ont été établis au Pakistan et aux Émirats arabes unis. Par ailleurs, beaucoup de pays utilisent désormais le système de surveillance des maladies et d’alerte précoce afin de pouvoir surveiller et prévoir les maladies liées à l’environnement. Dans huit pays, les prestataires de services de santé ont vu leurs capacités renforcées en matière de riposte aux accidents chimiques et de soins traumatologiques suite à une exposition à des agents chimiques nocifs. Des ressources scientifiques et des matériels de formation ont été mis à la disposition des pays dans plusieurs langues. Les capacités nationales en matière de préparation et de riposte aux événements d'origine chimique, radionucléaire et de sécurité sanitaire des aliments ont été renforcées, conformément au Règlement sanitaire international (2005). |
|